LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL RIBLET
FOREST :: VALLEE DE LA HAUTE MOSELLE, Rupt sur Moselle à Bussang :: "Recueil de témoignages sur le vécu sous la botte Allemande ( 39-45)
Page 1 sur 1
 LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL RIBLET
LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL RIBLET
Né le 29 Janvier 1917, j'ai été incorporé à l'armée en janvier 1937. J'ai fait deux ans d'armée au 15/3 à Rohrbach les Bitches (57).
A la fin de l'armée, comme la situation politique était instable à cause de l'Allemagne, je suis resté mobilisé, et en alerte permanente jusqu'à aout 1939.
Au printemps 1938, mon père, Joseph Riblet est décédé et je n'avais pas eu la permission de revenir pour l'enterrement.
Mais le malheur s'ajoutant au malheur, une de mes nièces, Andrée Riblet, qui n'avait que 12 ou 13 ans est morte noyée, avec une autre gamine du Thillot, une petite Gérard je crois, alors qu'elles se trouvaient en colonie de vacances à l'Ile d'Oléron (Charente Maritime), il me semble.
Trois autres filles sont mortes également avec elles ce jour là. Je crois savoir qu'elles ont été happées par une lame de fond. Lisant cela dans le journal, mon commandan , c'était un Corse, est venu me voir et m'a montré l'article.
Je lui ai dit que c'était ma nièce. Comme mon père et ma nièce sont morts en même temps, mon commandant a fait le nécessaire pour que je puisse revenir aux obsèques.
Je suis arrivé juste à temps pour les enterrements. Ils ont été mis en terre le même jou , l'un le matin , l'autre l'après midi.
A part la fois-là, je suis revenu peut être une ou deux fois pour les permissions agricoles, mes autres jours de « perm », je les ai laissés à la France.
Au régiment, j'étais avec un Choffel, le frère de l'ancien maire du Thillot et Georges Claude qui était lui aussi du Thillot. Ils sont morts maintenant, il ne reste plus que moi. Nous étions donc dans un ouvrage intermédiaire de la ligne Maginot.
Nous sommes restés maintenus sous les drapeaux jusqu'à la déclaration de guerre. La guerre déclarée, notre régiment a été divisé en trois parties. Le 15/3, le 16/6, dont je faisais partie, et le 133ème régiment d'infanterie.
Ça n'a pas duré longtemps, les Allemands ne nous ont pas attaqués de front, ils nous ont contournés en passant par le Nord. Je crois qu'un Général Français s'est rendu sur Thionville, les Boches ont fait une brèche dans notre ligne de défense et nous sont arrivés dans le dos au pied du Donon.
A ce moment là, nous avons dû changer de position afin de pouvoir faire face aux Allemands, et donc face à la France.
Je me suis battu le long du canal de la Marne au Rhin, à côté de Sarrebourg (Meurthe et Moselle), au niveau d'une carrière. Là, c'était triste.
La compagnie était montée à 180 bonshommes, elle en est redescendue à 59. Ça tombait comme des mouches. Moi j'étais brancardier, je peux vous dire que ce n'est pas le meilleur des postes. J'en ai vu des choses.
J'ai eu un copain qui a été tué sur le brancard en recevant un culot d'obus 77 Allemand.
Nous avons dû nous replier à plusieurs reprises, sur Bertranbois puis Lorquin (Meurthe et Moselle).
Les Allemands nous encerclant, nous devions trouver un passage pour nous enfuir et ne pas être faits prisonniers.
Nous avons vu notre commandant être fait prisonnier. Avec quelques-uns, nous avons pensé que notre salut était dans la fuite. On s'est caché et de nuit, on a remonté un ruisseau à l'aveuglette. On s'est retrouvé au Donon (67).
Au Donon , on a entendu sonner le « cesser le feu », par les clairons allemands et français .
Il y avait une sonnerie particulière pour le « Cessez le feu ». Ça faisait :« Hmm... tiré comme un cochon, tu n'auras pas d'condition, ta tala, ta tala.. ».
Alors on s'est demandé ce qu'on allait faire avec nos vieux fusils. C'est vrai qu'on se méfiait aussi de la 5ème colonne. ( Voir Lexique Ndr)
Et puis on s'est dit qu'on ne risquait plus rien puisque c'était le « Cessez le feu ».
Là, je me souviens que j'étais avec un gars de St Dié, qui a été tué par la suite d'ailleurs.
C'est bien simple, on est monté jusqu'au Donon, mais nous n'y sommes restés que quelques heures. On a été réveillé par des Allemands alors qu'on dormait. Là, nous ne nous sommes pas trop inquiétés puisque théoriquement on ne risquait plus rien.
C'est ce qu'on croyait, mais non, en réalité on était fait prisonnier.
Direction Sarrebourg à pied, où on est resté au moins quinze jours, à la caserne des Hulants. Je ne sais pas si elle existe encore.
On était au moins dix mille là-dedans. C'était un truc de fou! Rien que pour se coucher, il fallait se passer les uns sur les autres, c'était affreux.
Il fallait qu'on urine dans des boites de conserve avant d'aller jeter ça dehors.
On ne peut même pas en parler tellement c'était ... .
Et puis un beau jour, ils nous ont embarqués, direction l'Allemagne.
Je peux vous dire que ça a été dur pour nous de nous voir passer le pont de Sarralbe (Meurthe et Moselle) et que nous avons été beaucoup à penser qu'on devait sauter du train pour se sauver. Mais pas moyen.
Là, on a bien compris qu'on quittait la France. On était dans des wagons à bestiaux, par groupe de 40. On a donc traversé l'Allemagne, passé Berlin et nous sommes arrivés à « Porken » ( phonétique Ndr), près de Stettin ( Szczecin en Polonais - Ndr).
C'est un coin de Pologne que les Allemands avaient annexé. C'est au Nord Ouest de la Pologne, à la frontière Allemande, près de la mer Baltique, au bord du fleuve Oder.
Ils nous ont divisés en groupes. Moi je faisais partie d'un groupe de 25 Français. On a été placé dans une ferme pour travailler et remplacer les hommes qui combattaient pour le Reich.
C'était une grosse ferme d'état qui faisait au moins cinq ou six cent hectares.
Arrivés là, le régisseur de la ferme nous a répartis en fonction des postes à tenir.
Moi j'étais menuisier et charron. C'est là que j'ai appris à faire les roues de charrettes.
Un copain a été désigné pour s'occuper d'un cheval et donc de tout les travaux réalisables avec cet animal. C'était un cheval qui était méchant, fougueux, il donnait des coups de pied et personne n'avait pu le domestiquer jusque là.
Quand le copain, qui était fermier, s'est approché du cheval, ça c'est bien passé, au grand étonnement de l'Allemand qui lui a dit: « Tou, filou! ».
Si bien que le copain a gardé son cheval pendant les cinq ans de captivité. Il avait même droit d'en faire à la ferme.
Un autre copain qui parlait allemand nous lisait le journal, comme ça on savait un peu quelque chose de ce qui se passait en France.
L'Allemand avec qui j'étais était très gentil. Avec lui, tous les jours, j'avais droit à mon casse-croute.
Il faut dire qu'on n’ avait pas grand chose à manger. C'est bien simple j'ai mangé tous les jours des patates cuites à l'eau durant ma captivité. On avait aussi droit à un petit bout de viande de temps en temps. A cause de ces patates, j'ai même grossi.
Heureusement que parmi nous, il y avait un Normand qui savait braconner.
Une fois, il a réussi à faire comprendre à l'Allemand qui le surveillait que ce serait bien si on mangeait du chevreuil. L'Allemand n'a pas voulu, mais à force d'insister, il a fini par accepter.
Comme il y avait une forêt dans la propriété de la ferme, il a posé une « cravate » à un arbre, qu'il avait recourbé vers le sol.
Un chevreuil a passé la tête dans la « cravate » et s'est retrouvé pendu à l'arbre quand il s'est redressé.
Pour changer on a pu manger du chevreuil, ce qui était formellement interdit.
L'Allemand n'a rien dit, il a eu sa part.
On s'était interdit entre nous de tuer les souris. On se disait que les souris mangeaient le blé et que tout le blé mangé serait toujours celui que les boches n'auraient pas.
La ferme était isolée de l'extérieur par un haut grillage qui faisait trois mètres au moins. Derrière le grillage, il y avait la maison du régisseur. Il y avait toujours plein de poules autour de cette maison.
On les regardait avec envie en se disant qu'elles seraient bien dans notre gamelle.
Une fois on a réussi à pêcher une poule.
On avait accroché un bout de pain à une épingle à nourrice. On attachait une ficelle à l'épingle et on jetait le bout de pain de l'autre côté du grillage.
La poule a avalé le bout de pain et on l'a ferrée. On l'a ramenée à l'aide de la ficelle.
C'est comme ça aussi qu'on attrapait des faisans.
On est donc resté dans cette ferme tout le temps de la guerre, jusqu'à ce qu'on soit libéré par les troupes d'élite russes. C'était au mois de mai 1945, mais là c'est un peu flou dans ma tête. J'étais parti de la ferme avec un Allemand pour aller chercher du ravitaillement de l'autre côté de l'Oder.
Comme on y était arrivé le soir, on a dû y passer la nuit. Quand on s'est réveillé, notre camion avait disparu. C'était la débâcle allemande. Les gens et les soldats fuyaient les Russes. Les soldats allemands nous avaient piqué notre camion.
On s'est demandé ce qu'on devait faire, on a envisagé de retourner à la ferme, mais les boches s'étaient postés défensivement tout le long de l'Oder.
On ne pouvait plus passer par les ponts alors on a cherché une barque. On a fini par en trouver une.
Bien qu'il faisait encore nuit, tout l'Oder était éclairé par les Allemands, comme en plein jour.
On a réussi à passer l'Oder mais on a quand même été contrôlé par les Allemands de l'autre côté. Comme on avait un ordre de mission, on pensait qu'on pouvait retourner à « Porken », mais les Allemands nous ont dit que ce n'était plus la peine, la ferme ayant été abandonnée.
Je sais que c'est comme ça que le copain a dû se séparer de son cheval.
Je me suis donc retrouvé sur les routes sans trop savoir quoi faire. J'ai fini par retrouver des Français de la ferme et on a pris la direction de l'Allemagne à pied pour revenir en France. Je me souviens, mon copain pleurait d'avoir dû se séparer de son cheval.
Nous sommes donc descendus à pied sur « Baswalk », puis sur « Sassnitz » où nous avons retrouvé d'autres gars de la ferme.
A « Sassnitz » nous avons été rattrapés par les troupes d'élite Russes et leurs chars de 150 tonnes.
Je me souviens qu'à un moment, mon copain a reconnu son cheval, mais il n'a pas réussi à le récupérer.
Les Russes nous ont fouillés et ont compris qu'on était des prisonniers français. Au début ils étaient bruts avec nous, ils nous ont même menacés avec leurs fusils. Ils buvaient de la Vodka dans des grosses gourdes.
Ça a commencé à aller mieux avec eux quand on a accepté de boire un coup de vodka.
Elle était impossible à boire leur vodka, tellement elle brûlait. Eux ils buvaient ça comme de l'eau.
Une fois qu'on a bu la vodka, ils étaient heureux. « Fransouskis, camarades Fransouskis » qu'ils nous disaient.
Ensuite les troupes d'élite russes nous ont remis à l'armée régulière russe. Là c'était déjà un peu plus sérieux.
Au début nous n'étions que quelques dizaines, mais en peu de temps, on s'est vite retrouvé à plus de mille cinq cents. Nous avons été regroupés sur Berlin.
Ensuite les Russes nous ont conduits jusqu'au fleuve, l'Elbe, pour nous remettre aux Canadiens. Mais avant de nous remettre aux Canadiens, ils nous ont donné une mission, pour rendre service à nos libérateurs comme ils disaient.
Il fallait qu'on aille à « Gustrow » pour conduire des chevaux à Sassnitz où ils devaient être embarqués sur bateaux.
Nous avons tous été volontaires.
Ensuite les Russes nous ont fait passer le pont de l'Elbe alors que la frontière n'était ouverte que deux heures par jour. Ils ont vu avec les Canadiens qui ont réouvert la frontière juste pour nous.
On était bien avec les Canadiens, mais avec les Américains, ce n'était plus pareil!
Les Américains donnaient du beau pain blanc aux prisonniers allemands et nous on devait manger du pain noir fait avec du seigle qui n'était même pas moulu.
Là je peux vous dire que ça m'a resté là. Ça a eu du mal à passer! Après ce qu'on avait vécu, on était révolté de voir les Boches manger du bon pain blanc.
Ensuite, depuis là, nous devions rentrer en France en avion, mais un contingent anglais nous est passé sous le nez et ce sont eux qui ont eu droit aux avions. Nous avons donc eu droit aux camions qui nous ont transportés jusqu'à Bruxelles.
Entre temps, nous avons eu droit à un peu de train, c'était en Allemagne.
Les voies ferrées étaient en très mauvais état. Je me souviens qu'on avait dû attendre 24 heures dans le train, à la même place, dans l'attente que les voies soient réparées.
On est passés par Dusseldorf, Cologne. Arrivés à Bruxelles, il y avait un monde fou.
Plein de gens nous demandaient « Vous ne connaissez pas untel? Vous n'avez pas vu untel? ». C'était une pagaille monstre, et on était bien obligé de répondre non à toutes ces questions. C'était infernal à vivre.
On a fini par arriver à Lille où nous avons tous dû passer des visites médicales et des radios.
Ça criait dans tous les coins, tout le monde était pressé de rentrer chez lui mais il nous fallait attendre encore et encore pour passer ces visites. Je suis donc resté sur Lille quatre ou cinq longs jours.
J'ai ensuite repris le train, suis arrivé à Nancy où j'ai dû repasser des radios, puis à Epinal pour me faire démobiliser.
Arrivé à Remiremont, il n'y avait plus de train, les voies n'étant pas réparées.
Devant la gare, j'ai rencontré un nommé Roch , que je connaissais et qui faisait les navettes de marchandises jusqu'au Thillot pour remplacer le train qui ne passait plus. Il m'a dit de monter dans la benne de sa camionnette, c'est comme ça que j'ai rejoint le Thillot.
Sur le trajet, je me demandais bien ce que j'allais trouver chez moi.
Je suis donc arrivé au Thillot le 23 Juin 1945, ça faisait donc presque deux mois que j'avais quitté Stéttin. Là j'ai rencontré Mr Rivat un voisin qui m'a dit que ma mère était toujours à la ferme. Lorsque ma mère m'a accueilli, elle n'avait plus de nouvelles de moi depuis six mois.
J'ai donc eu de la chance, j'ai traversé la guerre sans être blessé. J'ai juste perdu deux doigts de pied qui ont été gelés vers Stettin en Pologne. Il faut dire qu'il faisait froid en Poméranie. Mais je n'ai rien à reprocher aux Allemands, ils m'ont bien soigné.
A la fin de l'armée, comme la situation politique était instable à cause de l'Allemagne, je suis resté mobilisé, et en alerte permanente jusqu'à aout 1939.
Au printemps 1938, mon père, Joseph Riblet est décédé et je n'avais pas eu la permission de revenir pour l'enterrement.
Mais le malheur s'ajoutant au malheur, une de mes nièces, Andrée Riblet, qui n'avait que 12 ou 13 ans est morte noyée, avec une autre gamine du Thillot, une petite Gérard je crois, alors qu'elles se trouvaient en colonie de vacances à l'Ile d'Oléron (Charente Maritime), il me semble.
Trois autres filles sont mortes également avec elles ce jour là. Je crois savoir qu'elles ont été happées par une lame de fond. Lisant cela dans le journal, mon commandan , c'était un Corse, est venu me voir et m'a montré l'article.
Je lui ai dit que c'était ma nièce. Comme mon père et ma nièce sont morts en même temps, mon commandant a fait le nécessaire pour que je puisse revenir aux obsèques.
Je suis arrivé juste à temps pour les enterrements. Ils ont été mis en terre le même jou , l'un le matin , l'autre l'après midi.
A part la fois-là, je suis revenu peut être une ou deux fois pour les permissions agricoles, mes autres jours de « perm », je les ai laissés à la France.
Au régiment, j'étais avec un Choffel, le frère de l'ancien maire du Thillot et Georges Claude qui était lui aussi du Thillot. Ils sont morts maintenant, il ne reste plus que moi. Nous étions donc dans un ouvrage intermédiaire de la ligne Maginot.
Nous sommes restés maintenus sous les drapeaux jusqu'à la déclaration de guerre. La guerre déclarée, notre régiment a été divisé en trois parties. Le 15/3, le 16/6, dont je faisais partie, et le 133ème régiment d'infanterie.
Ça n'a pas duré longtemps, les Allemands ne nous ont pas attaqués de front, ils nous ont contournés en passant par le Nord. Je crois qu'un Général Français s'est rendu sur Thionville, les Boches ont fait une brèche dans notre ligne de défense et nous sont arrivés dans le dos au pied du Donon.
A ce moment là, nous avons dû changer de position afin de pouvoir faire face aux Allemands, et donc face à la France.
Je me suis battu le long du canal de la Marne au Rhin, à côté de Sarrebourg (Meurthe et Moselle), au niveau d'une carrière. Là, c'était triste.
La compagnie était montée à 180 bonshommes, elle en est redescendue à 59. Ça tombait comme des mouches. Moi j'étais brancardier, je peux vous dire que ce n'est pas le meilleur des postes. J'en ai vu des choses.
J'ai eu un copain qui a été tué sur le brancard en recevant un culot d'obus 77 Allemand.
Nous avons dû nous replier à plusieurs reprises, sur Bertranbois puis Lorquin (Meurthe et Moselle).
Les Allemands nous encerclant, nous devions trouver un passage pour nous enfuir et ne pas être faits prisonniers.
Nous avons vu notre commandant être fait prisonnier. Avec quelques-uns, nous avons pensé que notre salut était dans la fuite. On s'est caché et de nuit, on a remonté un ruisseau à l'aveuglette. On s'est retrouvé au Donon (67).
Au Donon , on a entendu sonner le « cesser le feu », par les clairons allemands et français .
Il y avait une sonnerie particulière pour le « Cessez le feu ». Ça faisait :« Hmm... tiré comme un cochon, tu n'auras pas d'condition, ta tala, ta tala.. ».
Alors on s'est demandé ce qu'on allait faire avec nos vieux fusils. C'est vrai qu'on se méfiait aussi de la 5ème colonne. ( Voir Lexique Ndr)
Et puis on s'est dit qu'on ne risquait plus rien puisque c'était le « Cessez le feu ».
Là, je me souviens que j'étais avec un gars de St Dié, qui a été tué par la suite d'ailleurs.
C'est bien simple, on est monté jusqu'au Donon, mais nous n'y sommes restés que quelques heures. On a été réveillé par des Allemands alors qu'on dormait. Là, nous ne nous sommes pas trop inquiétés puisque théoriquement on ne risquait plus rien.
C'est ce qu'on croyait, mais non, en réalité on était fait prisonnier.
Direction Sarrebourg à pied, où on est resté au moins quinze jours, à la caserne des Hulants. Je ne sais pas si elle existe encore.
On était au moins dix mille là-dedans. C'était un truc de fou! Rien que pour se coucher, il fallait se passer les uns sur les autres, c'était affreux.
Il fallait qu'on urine dans des boites de conserve avant d'aller jeter ça dehors.
On ne peut même pas en parler tellement c'était ... .
Et puis un beau jour, ils nous ont embarqués, direction l'Allemagne.
Je peux vous dire que ça a été dur pour nous de nous voir passer le pont de Sarralbe (Meurthe et Moselle) et que nous avons été beaucoup à penser qu'on devait sauter du train pour se sauver. Mais pas moyen.
Là, on a bien compris qu'on quittait la France. On était dans des wagons à bestiaux, par groupe de 40. On a donc traversé l'Allemagne, passé Berlin et nous sommes arrivés à « Porken » ( phonétique Ndr), près de Stettin ( Szczecin en Polonais - Ndr).
C'est un coin de Pologne que les Allemands avaient annexé. C'est au Nord Ouest de la Pologne, à la frontière Allemande, près de la mer Baltique, au bord du fleuve Oder.
Ils nous ont divisés en groupes. Moi je faisais partie d'un groupe de 25 Français. On a été placé dans une ferme pour travailler et remplacer les hommes qui combattaient pour le Reich.
C'était une grosse ferme d'état qui faisait au moins cinq ou six cent hectares.
Arrivés là, le régisseur de la ferme nous a répartis en fonction des postes à tenir.
Moi j'étais menuisier et charron. C'est là que j'ai appris à faire les roues de charrettes.
Un copain a été désigné pour s'occuper d'un cheval et donc de tout les travaux réalisables avec cet animal. C'était un cheval qui était méchant, fougueux, il donnait des coups de pied et personne n'avait pu le domestiquer jusque là.
Quand le copain, qui était fermier, s'est approché du cheval, ça c'est bien passé, au grand étonnement de l'Allemand qui lui a dit: « Tou, filou! ».
Si bien que le copain a gardé son cheval pendant les cinq ans de captivité. Il avait même droit d'en faire à la ferme.
Un autre copain qui parlait allemand nous lisait le journal, comme ça on savait un peu quelque chose de ce qui se passait en France.
L'Allemand avec qui j'étais était très gentil. Avec lui, tous les jours, j'avais droit à mon casse-croute.
Il faut dire qu'on n’ avait pas grand chose à manger. C'est bien simple j'ai mangé tous les jours des patates cuites à l'eau durant ma captivité. On avait aussi droit à un petit bout de viande de temps en temps. A cause de ces patates, j'ai même grossi.
Heureusement que parmi nous, il y avait un Normand qui savait braconner.
Une fois, il a réussi à faire comprendre à l'Allemand qui le surveillait que ce serait bien si on mangeait du chevreuil. L'Allemand n'a pas voulu, mais à force d'insister, il a fini par accepter.
Comme il y avait une forêt dans la propriété de la ferme, il a posé une « cravate » à un arbre, qu'il avait recourbé vers le sol.
Un chevreuil a passé la tête dans la « cravate » et s'est retrouvé pendu à l'arbre quand il s'est redressé.
Pour changer on a pu manger du chevreuil, ce qui était formellement interdit.
L'Allemand n'a rien dit, il a eu sa part.
On s'était interdit entre nous de tuer les souris. On se disait que les souris mangeaient le blé et que tout le blé mangé serait toujours celui que les boches n'auraient pas.
La ferme était isolée de l'extérieur par un haut grillage qui faisait trois mètres au moins. Derrière le grillage, il y avait la maison du régisseur. Il y avait toujours plein de poules autour de cette maison.
On les regardait avec envie en se disant qu'elles seraient bien dans notre gamelle.
Une fois on a réussi à pêcher une poule.
On avait accroché un bout de pain à une épingle à nourrice. On attachait une ficelle à l'épingle et on jetait le bout de pain de l'autre côté du grillage.
La poule a avalé le bout de pain et on l'a ferrée. On l'a ramenée à l'aide de la ficelle.
C'est comme ça aussi qu'on attrapait des faisans.
On est donc resté dans cette ferme tout le temps de la guerre, jusqu'à ce qu'on soit libéré par les troupes d'élite russes. C'était au mois de mai 1945, mais là c'est un peu flou dans ma tête. J'étais parti de la ferme avec un Allemand pour aller chercher du ravitaillement de l'autre côté de l'Oder.
Comme on y était arrivé le soir, on a dû y passer la nuit. Quand on s'est réveillé, notre camion avait disparu. C'était la débâcle allemande. Les gens et les soldats fuyaient les Russes. Les soldats allemands nous avaient piqué notre camion.
On s'est demandé ce qu'on devait faire, on a envisagé de retourner à la ferme, mais les boches s'étaient postés défensivement tout le long de l'Oder.
On ne pouvait plus passer par les ponts alors on a cherché une barque. On a fini par en trouver une.
Bien qu'il faisait encore nuit, tout l'Oder était éclairé par les Allemands, comme en plein jour.
On a réussi à passer l'Oder mais on a quand même été contrôlé par les Allemands de l'autre côté. Comme on avait un ordre de mission, on pensait qu'on pouvait retourner à « Porken », mais les Allemands nous ont dit que ce n'était plus la peine, la ferme ayant été abandonnée.
Je sais que c'est comme ça que le copain a dû se séparer de son cheval.
Je me suis donc retrouvé sur les routes sans trop savoir quoi faire. J'ai fini par retrouver des Français de la ferme et on a pris la direction de l'Allemagne à pied pour revenir en France. Je me souviens, mon copain pleurait d'avoir dû se séparer de son cheval.
Nous sommes donc descendus à pied sur « Baswalk », puis sur « Sassnitz » où nous avons retrouvé d'autres gars de la ferme.
A « Sassnitz » nous avons été rattrapés par les troupes d'élite Russes et leurs chars de 150 tonnes.
Je me souviens qu'à un moment, mon copain a reconnu son cheval, mais il n'a pas réussi à le récupérer.
Les Russes nous ont fouillés et ont compris qu'on était des prisonniers français. Au début ils étaient bruts avec nous, ils nous ont même menacés avec leurs fusils. Ils buvaient de la Vodka dans des grosses gourdes.
Ça a commencé à aller mieux avec eux quand on a accepté de boire un coup de vodka.
Elle était impossible à boire leur vodka, tellement elle brûlait. Eux ils buvaient ça comme de l'eau.
Une fois qu'on a bu la vodka, ils étaient heureux. « Fransouskis, camarades Fransouskis » qu'ils nous disaient.
Ensuite les troupes d'élite russes nous ont remis à l'armée régulière russe. Là c'était déjà un peu plus sérieux.
Au début nous n'étions que quelques dizaines, mais en peu de temps, on s'est vite retrouvé à plus de mille cinq cents. Nous avons été regroupés sur Berlin.
Ensuite les Russes nous ont conduits jusqu'au fleuve, l'Elbe, pour nous remettre aux Canadiens. Mais avant de nous remettre aux Canadiens, ils nous ont donné une mission, pour rendre service à nos libérateurs comme ils disaient.
Il fallait qu'on aille à « Gustrow » pour conduire des chevaux à Sassnitz où ils devaient être embarqués sur bateaux.
Nous avons tous été volontaires.
Ensuite les Russes nous ont fait passer le pont de l'Elbe alors que la frontière n'était ouverte que deux heures par jour. Ils ont vu avec les Canadiens qui ont réouvert la frontière juste pour nous.
On était bien avec les Canadiens, mais avec les Américains, ce n'était plus pareil!
Les Américains donnaient du beau pain blanc aux prisonniers allemands et nous on devait manger du pain noir fait avec du seigle qui n'était même pas moulu.
Là je peux vous dire que ça m'a resté là. Ça a eu du mal à passer! Après ce qu'on avait vécu, on était révolté de voir les Boches manger du bon pain blanc.
Ensuite, depuis là, nous devions rentrer en France en avion, mais un contingent anglais nous est passé sous le nez et ce sont eux qui ont eu droit aux avions. Nous avons donc eu droit aux camions qui nous ont transportés jusqu'à Bruxelles.
Entre temps, nous avons eu droit à un peu de train, c'était en Allemagne.
Les voies ferrées étaient en très mauvais état. Je me souviens qu'on avait dû attendre 24 heures dans le train, à la même place, dans l'attente que les voies soient réparées.
On est passés par Dusseldorf, Cologne. Arrivés à Bruxelles, il y avait un monde fou.
Plein de gens nous demandaient « Vous ne connaissez pas untel? Vous n'avez pas vu untel? ». C'était une pagaille monstre, et on était bien obligé de répondre non à toutes ces questions. C'était infernal à vivre.
On a fini par arriver à Lille où nous avons tous dû passer des visites médicales et des radios.
Ça criait dans tous les coins, tout le monde était pressé de rentrer chez lui mais il nous fallait attendre encore et encore pour passer ces visites. Je suis donc resté sur Lille quatre ou cinq longs jours.
J'ai ensuite repris le train, suis arrivé à Nancy où j'ai dû repasser des radios, puis à Epinal pour me faire démobiliser.
Arrivé à Remiremont, il n'y avait plus de train, les voies n'étant pas réparées.
Devant la gare, j'ai rencontré un nommé Roch , que je connaissais et qui faisait les navettes de marchandises jusqu'au Thillot pour remplacer le train qui ne passait plus. Il m'a dit de monter dans la benne de sa camionnette, c'est comme ça que j'ai rejoint le Thillot.
Sur le trajet, je me demandais bien ce que j'allais trouver chez moi.
Je suis donc arrivé au Thillot le 23 Juin 1945, ça faisait donc presque deux mois que j'avais quitté Stéttin. Là j'ai rencontré Mr Rivat un voisin qui m'a dit que ma mère était toujours à la ferme. Lorsque ma mère m'a accueilli, elle n'avait plus de nouvelles de moi depuis six mois.
J'ai donc eu de la chance, j'ai traversé la guerre sans être blessé. J'ai juste perdu deux doigts de pied qui ont été gelés vers Stettin en Pologne. Il faut dire qu'il faisait froid en Poméranie. Mais je n'ai rien à reprocher aux Allemands, ils m'ont bien soigné.

yves philippe- MODERATEUR
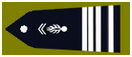
- Nombre de messages : 2134
Ville : le Ménil
Age : 60
Points : 2755
Date d'inscription : 28/12/2010

yves philippe- MODERATEUR
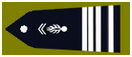
- Nombre de messages : 2134
Ville : le Ménil
Age : 60
Points : 2755
Date d'inscription : 28/12/2010
 Sujets similaires
Sujets similaires» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL MILLOTTE
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL VANNSON
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL KURTZMANN
» BUSSANG - SOUVENIRS DE MARCEL MANGEL
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MICHEL THIEBAUTGEORGES
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL VANNSON
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL KURTZMANN
» BUSSANG - SOUVENIRS DE MARCEL MANGEL
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MICHEL THIEBAUTGEORGES
FOREST :: VALLEE DE LA HAUTE MOSELLE, Rupt sur Moselle à Bussang :: "Recueil de témoignages sur le vécu sous la botte Allemande ( 39-45)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
