LE THILLOT - SOUVENIRS DEMARIE DOMINIQUE PEDUZZI VVE LUCIEN CHEVRIER EXTRAITS DE SES MEMOIRES
FOREST :: VALLEE DE LA HAUTE MOSELLE, Rupt sur Moselle à Bussang :: "Recueil de témoignages sur le vécu sous la botte Allemande ( 39-45)
Page 1 sur 1
 LE THILLOT - SOUVENIRS DEMARIE DOMINIQUE PEDUZZI VVE LUCIEN CHEVRIER EXTRAITS DE SES MEMOIRES
LE THILLOT - SOUVENIRS DEMARIE DOMINIQUE PEDUZZI VVE LUCIEN CHEVRIER EXTRAITS DE SES MEMOIRES
(...)Nous voici aux grandes vacances 1939. Les adultes lisent les journaux avec inquiétude et ceux qui possèdent une TSF (Télégraphie Sans Fil, c'est-à-dire la radio - Ndr) écoutent avec intérêt les informations pour raconter aux autres les nouvelles.
C'est ainsi que « mère Blaise » annonce les changements du gouvernement en ces termes : « Le cabinet est renversé » .... puis un peu plus tard, ... « un nouveau cabinet est formé ».
Le lendemain, les mêmes propos reviennent, et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Les uns hochent la tête, les autres palabrent. Nous les jeunes, nous n'y comprenons rien, et on s’en moque.
Même le jour de la déclaration de guerre, nous ne nous inquiétons pas, bien des adultes aussi.
Les hommes sont graves, les femmes pleurent, les enfants dont les pères sont mobilisables en sont presque fiers et considèrent de haut ceux dont le père restera à la maison.
De toute façon, disent ils, les Boches seront bientôt battus.
Cela deviendra un refrain, pour eux et pour hélas beaucoup d'autres.
Voilà donc la guerre déclarée contre l'Allemagne. Pour bien des gens, cela ne change pas grand chose. Le travail continue. Les soldats viennent en permission, repartent et laissent bien souvent, sans le savoir, un bébé « mis en chantier » pendant la durée de leur séjour en famille. C'est ainsi que bien des enfants et des papas ne se connurent que cinq ans plus tard, ou ne se connurent pas du tout.
Il fallut camoufler toute source de lumière dès la nuit tombée (ordre de la défense passive). Nos fenêtres n'avaient pas de volets, alors maman a teint de vieux draps en bleu foncé que nous accrochions tous les soirs d'automne et d'hiver. L'un de nous sortait afin de regarder si aucune lumière ne passait ! Nous ne pensions pas du tout aux restrictions, la France était si riche.
Notre année scolaire a commencé par un discours de madame la Directrice et avec quelques élèves supplémentaires, des Parisiens, envoyés par des parents prévoyants dans leur famille thillotine et aussi quelques Alsaciens. (...)
L'année 1940 a commencé dans la morosité pour tous. (...) En avril, je suis allée à l'hôpital à Nancy pour quelques jours. Je devais être opérée des amygdales et des végétations. J'étais âgée pour cette opération et le médecin de famille avait préféré m'envoyer aussi loin ! (...)
Au retour, le train était bondé de soldats allant en permission, qui riaient, chantaient et chahutaient (surtout les jeunes), heureux de retrouver leur famille. Ce fut je crois les dernières permissions accordées.
Arrive le joli moi de mai, si joli cette année, et le dimanche de Pentecôte. Il faisait un temps superbe, chaud et ensoleillé. La nature elle aussi était en fête.
C'est le curé de la paroisse qui officiait. Mobilisé, il avait bénéficié d'une permission et nous a fait une belle cérémonie. Il a su nous dire, avec des mots simples, sa joie d'être parmi nous et son émotion de voir avec quelle ferveur s'étaient joints les parents et amis des enfants. Il a terminé en nous disant à tous, petits et grands, d'être braves et courageux pendant les temps à venir. Capitaine dans l'armée, il se doutait de ce qui allait suivre. Il a terminé son sermon (on dit homélie maintenant) par cette phrase qui a fait sourire toute l'assemblée: « Que personne ne fasse de péché de gourmandise dans aucun domaine! »
Ce n'était pas encore le temps des restrictions. (...)
Au 08 juin 1940, nous sommes encore allés en classe pendant quelques jours. Avec une camarade, nous enlevions les livres de classe pour les mettre à l'abri dans les caves de la mairie. C'est là, pendant une alerte que, réfugiées dans le couloir de la cave, nous avons vu deux messieurs, bien habillés, s'asseoir à la terrasse du restaurant de la mairie, et parler entre eux dans une langue que nous ne comprenions pas. C'était de l'allemand.
Hélas, la mairie et toutes les maisons de la place ont été brûlées par les Allemands lors de leur entrée au Thillot, y compris les livres de la classe mis à l'abri !
Je me souviendrai toujours de la date du 10 juin 1940, jour où j'ai vu pleurer papa. Le jour mémorable où Mussolini a déclaré la guerre à la France en s'unissant avec Hitler. Cela, papa ne l'a jamais admis, lui qui s'était déjà battu en 1917 avec les Français. Il ne comprenait pas la désaffection de l'Italie.
C'est peu après qu'il a pris la route avec beaucoup d'autres, pour s'éloigner des Allemands qui arrivaient. Au bout de deux jours, il avait parcouru une centaine de kilomètres. Devant la pagaille qu'il voyait sur la route, il a pensé qu'il serait aussi bien à la maison avec nous, et a rebroussé chemin. Songez à notre joie quand nous l'avons revu. Il avait marché jusqu'à Gray, en Haute Saône.
Les soldats français se retiraient de la zone alsacienne et ont cantonné près de chez nous. Il y en avait partout dans les cours, autour des maisons et dans le parc en face de notre cité. Ils y avaient monté une batterie de mitrailleuse. Quand le soir est arrivé, il a fallu trouver où loger ces hommes. Nous n'avions pas de place, mais mes parents ont laissé la porte de la cuisine ouverte et quelques uns sont venus y dormir. Les chaises étaient mises sur la table pour faire de la place. Le lendemain matin, tous étaient partis, mais avaient laissés en évidence, une boite de cinq kilos de sucre en poudre, en remerciement.
La batterie était toujours en place, eux restaient. Le capitaine qui commandait les hommes a prévenu les adultes. Que ceux qui le pouvaient partent dans un endroit plus calme dans les environs.
Nous avions des amis italiens habitant dans une ferme dans la montagne, à Chaillon, près du bois. Papa est parti aussitôt leur demander asile pendant que nous préparions quelques vêtements et victuailles. Sitôt son retour, nous sommes partis d'un bon pied, rassurés que nous ne risquions plus rien. Si nous avions su!
Tante Marie, sa maman et le pensionnaire (un homme âgé), sont venus avec nous. Le vieil homme avait emmené les quelques poules de ma tante dans un sac bien fermé, si bien fermé qu'une partie des bêtes étaient mortes étouffées à leur arrivée!
C'était en juin, en pleine saison des foins. La ferme se trouvait à flanc de montagne, faisant vis à vis, à quelques kilomètres de là, à d'autres fermes situées elles aussi à flanc de montagne, mais en Haute Saône.
Les deux premiers jours, tout fut calme, mais le troisième, quel changement! Les soldats cantonnés au Thillot résistaient aux troupes allemandes venant d'Alsace et à celles arrivées jusqu'au petit village Franc-Comtois de Château Lambert sis en haut de la cuvette dont le Thillot forme le fond.
Par conséquent les Allemands se trouvaient de l'autre côté de là où nous nous étions réfugiés. Nous ne le savions pas.
Les grands et petits fanaient, au cœur de l'après midi, le foin que les hommes avaient fauché le matin, afin de tout rentrer le soir.
Tout le monde vient de quitter le pré du haut pour une petite collation quand une pluie d'obus est tombée dans le pré qui venait d'être quitté. Grâce à cela, personne ne fût blessé mais le travail a été terminé pour le reste de la journée. Nous avons eu une fameuse frousse, vous pouvez le croire!
Les soldats allemands, depuis le promontoire comtois avaient remarqué une grande activité chez leurs vis à vis et en avaient conclu qu'il se tenait là une batterie qu'il fallait vaincre.
Personne n'a voulu passer la nuit dans la maison et nous sommes allés dans une grange indépendante située un peu en retrait de la ferme. Nous n'avons guère dormi tant la peur nous tenaillait en entendant les détonations. La bataille a duré toute la nuit.
Vers sept heures, le lendemain matin, des avions passant en rase motte ont lancé des tracts nous enjoignant de nous rendre, que la guerre était finie, qu'ils avaient gagné. C'était écrit en français et en allemand.
Des adultes, abattus, découragés, se sont concertés, les hommes âgés sont descendus vers la ville, chacun par un chemin différent, pour aller aux nouvelles. Quand papa est revenu, il nous a appris qu'il y avait d'énormes dégâts, les ponts avaient sauté, toutes les maisons de la place de la mairie étaient détruites. Le parc Beluche, où était la batterie, en face de chez nous, n'était plus qu'un terrain plein de trous. Les soldats s'étaient vaillamment défendus et avaient tous été tués, avec à leur tête le Capitaine Belhomme.
Papa a ajouté: « C'est une honte, il y a des gens qui volent dans les magasins dont les vitrines sont pulvérisées. Je me suis sauvé, de peur de reconnaître des personnes de connaissance ».
C'est je crois, ce qui l'a le plus choqué de cette première journée de défaite.
Nous sommes encore restés une journée à la ferme et avons retrouvé notre logement ainsi que nos voisins qui étaient restés sur place en vivant à la cave, et aussi ceux, qui comme nous, rentraient des environs. Des habitants étaient partis dès les premiers jours et beaucoup ont préféré rester là où ils étaient arrivés, pour s'établir définitivement, en zone libre, comme nous disions.
Pour nous, la guerre était terminée avec des soldats allemands cantonnés aux lieux et places des soldats français, une dizaine de jours auparavant. Nous avons eu droit à la parade et au défilé chantant tous les jours. Deux sentinelles étaient postées à l'entrée du parc, près de chez nous. Cela ne nous empêchait pas, nous les enfants, d'aller y jouer et nous défouler sans contrainte, surtout au début. Il y eu interdiction plus tard.
J'étais jeune et j'aimais chanter en travaillant dans la maison. Je passais facilement des cantiques aux chansons patriotiques que j'avais apprises pour le certificat d'études. J'aimais tout particulièrement “La Marseillaise” pour son rythme entraînant. C'est ainsi qu'un matin, trois ou quatre jours après la défaite, je chantais à tue-tête quand une voisine fait irruption dans notre cuisine, toute affolée: « Malheureuse! Tais-toi ! Si les Allemands t'entendent, tu peux être fusillée! Nous n'avons plus le droit de chanter ces chansons-là! Quelle peur tu m'as faite! ». dit-elle encore.
J'ai tout de suite compris la leçon. Je n'ai plus chanté pendant longtemps. Je pensais toujours à ce que m'avait dit Léa Marsot.
Les Allemands avaient installé une « popote » pour leurs soldats, dans la cour du marchand de charbon Laroche. Bien des enfants allaient quémander du pain en disant au cuistot : « Brot, Brot ». Nous allions aussi voir les soldats, mais ne leur avons jamais rien demandé. Le riz aux pruneaux ne nous tentait guère, et puis, nous avions déjà notre fierté!
Nous n'avions pas de poste TSF, ne savions pas grand chose des évènements, sauf ce qu'imprimait le journal. Ceux qui se tenaient au courant chuchotaient aux oreilles des adultes et prenaient des mines averties, dès que les enfants se joignaient à eux pour écouter.
Fin juin ou juillet, les Allemands nous firent changer d'heure pour s'adapter à l'heure allemande. Je crois que nous retardions d'une heure par rapport à eux. C'est à peu près à la même époque que les restrictions commencèrent à se faire sentir. Ce fut aussi le temps des premières queues devant les épiceries et boulangeries. Les boucheries un peu plus tard seulement.
Alors, tous les jours, (c’était le temps des vacances scolaires), dès sept heures du matin, je partais pour être dans les premières devant la porte de la boutique et avoir un numéro pour revenir à l'heure de l'ouverture. Maman disait: « Les premiers arrivés, les mieux servis ». Une fermière devant chez qui je passais tous les matins m'a demandé un jour si je travaillais. Elle me voyait passer tous les jours à la même heure, cela l'intriguait fortement.
Ce fut au début du mois de juillet que nous avons appris par une jeune femme, parente d'une de nos voisines, que la femme de mon parrain, « Tante Honorine », était décédée à l'hôpital d'Epinal. Elle avait été tuée par un éclat d'obus en cueillant des pois dans son jardin.
Cette jeune femme allait voir son mari blessé lors des derniers combats quand elle a vu sur un tableau d'affichage les noms des décédés de la veille. Comme elle connaissait le nom patronymique de maman, elle nous a prévenus dès son arrivée au Thillot. (...)
A la rentrée scolaire, j'entrais au cours complémentaire avec un maître ou une maîtresse pour chaque discipline. Certains faisaient deux cours de suite. Nous apprenions aussi une langue étrangère (l’allemand obligatoirement, bien sûre). La première année s'était passée facilement, comme au temps du primaire.
L'hiver 40/41 est arrivé, avec la force et la rigueur de notre région. La nuit, il fallait toujours camoufler les ouvertures. L'habitude était prise.
Un soir, je terminais mes devoirs quand on a frappé à la porte avec insistance et j'entendais un parlé rugueux. J'ai juste entrouvert la porte et me suis retrouvé nez à nez avec un soldat allemand. Au même moment, la voisine mitoyenne a ouvert chez elle. Tout est rentré bien vite dans l'ordre, le monsieur en question s'était tout simplement trompé de porte. Cela a duré paraît-il pendant toutes les années d'occupation, avec changement de partenaires, selon les départs et les arrivées de nouvelles troupes bien sûr. (...)
L'année 1941 a passé, comme la précédente avec les restrictions, les cartes d'alimentation, de vêtements et de tabac, avec la peur (déjà) et la peine des familles des prisonniers.
La résistance, composée de civils, commençait à pointer de ci de là tandis que les Allemands traquaient les Juifs. (...)
Mon oncle, démobilisé a été contraint, à la suite d'une histoire avec un Allemand, de partir travailler en Allemagne. Son fils, Lucien, démobilisé lui aussi, travaillait dans les fermes aux alentours d'Epinal. (...) Il a été lui aussi requis par le STO en septembre 1942. Pendant son séjour, il avait connu plusieurs jeunes gens qui recrutaient de futurs résistants. Il savait qu'il pouvait s'adresser à l'un d'eux en cas de « pépin ». Aussi, sans nous en parler, il avait pris contact avec celui qui lui avait laissé entendre qu'il savait où le loger au cas où... .
Il était revenu une fois en permission d'Allemagne, mais plutôt que de repartir, il était resté à Epinal où il s'est fait prendre.
L'année 1943 était commencée quand un jour, au bureau, je reçois un coup de téléphone de Robert. Il me disait: « Je vais partir pour un temps assez long. Que personne ne s'inquiète ».
Je n'y comprenais rien et il ne m'a pas donné plus d'explication. Aussi, quelle n'a pas été notre surprise, quelque temps après, lorsqu'une lettre est arrivée à la maison, me convoquant à la Kommandantur à Epinal. Maman m'a accompagnée. Je peux vous dire que je n'en menais pas large! Nous fûmes reçues par un subalterne qui voulait connaître l'adresse de mon cousin. Il me questionna sur ses occupations antérieures et du moment. Je lui ai répondu que depuis son coup de téléphone de telle date nous étions sans nouvelle mais que nous ne nous faisions pas de soucis puisqu'il nous avait dit qu'il serait absent très longtemps. Cela a dû satisfaire l'Allemand puisqu'il nous a laissées repartir sans autres questions. Il n'y a pas eu de suite à cette convocation.
Nous avons su par la suite, les circonstances de son arrestation. Il revenait à la maison quand « ramassé » à la gare, avec d'autres jeunes gens, il n'a rien dit pour ne pas rendre mes parents suspects et a demandé à me téléphoner, (un policier en civil avait l'écouteur). Ce fut forcément assez bref, après quoi tous ont été embarqués sans explication dans un train en partance, mais pas dans la direction prévue par chacun.
Mon cousin avait pris toutes ses affaires et était aussi chargé qu'un baudet avec son énorme sac à dos ... c'est ce qui lui a permis de faire évader et s'évader lui même les quatre jeunes gens qui étaient dans la même situation que lui. Ils ont réussi à sauter du train et à s'évanouir dans la nature. Je crois qu'un seul s'est blessé en tombant. Robert obstruait le couloir grâce au volume de son sac à dos tandis que les autres pouvaient ouvrir la portière et sauter sur le ballast.
J'ai revu Robert récemment, il m'a confirmé cette version en ajoutant que seuls lui et le jeune blessé se sont sortis de cette aventure.
Et puis, un soir de printemps, après le passage de l'autorail (nous habitions en bordure de la voie ferrée Epinal – Bussang) qui voyons nous arriver ? Robert. Il nous a raconté ses péripéties et a dit qu'il devait aller dans une ferme, chez Madame Alice, à la colline de Fresse. Nous avons dressé l'oreille, (quand je dis nous, il s'agit de mes parents et moi) car nous allions chez cette personne pour acheter des fromages. Elle nous avait même cédé un champ qu'elle ne cultivait plus, faute de bras pour le faire. Papa l'avait planté en pommes de terre.
Mon père a donc été tout de suite d'accord pour emmener mon cousin dès la nuit tombée, Il est revenu dans le milieu de la nuit et a repris son travail normalement. Personne n'a jamais connu le récit de ce voyage nocturne. Mon cousin faisait son travail dans cette ferme et si le soir il s'égaillait et rentrait avant le point du jour, personne ne lui posait de question. Cela a duré jusqu'en 1944 où quelques patrouilles d'Allemands qui donnèrent des ennuis à certains, firent redoubler d'attention les maquisards, surtout après le débarquement.
Je me rappelle de ce jour où, montée avec papa pour butter les pommes de terre, nous étions assis avec Alice, en train de boire le café quand deux Allemands sont arrivés, le fusil à la bretelle. Ils ont eu droit, bien sûre à la tasse de café. C'étaient deux hommes d'une cinquantaine d'années, bien désabusés déjà. L'un avait l'ongle d'un pouce tout noir, un coup de marteau a-t-il dit.
« Quand mon ongle sera tombé et repoussé, cela va durer six mois, la guerre sera finie, ou presque » nous dit- il dans un français approximatif mais compréhensible. (...)
Nous entrons dans l'année 1944, l'hiver est toujours aussi rigoureux. La guerre continue, la résistance s'intensifie et la vie quotidienne va cahincaha. Chez nous, nous n'avions pas de TSF et ne connaissions des événements, seulement, ce que le journal publiait, c'est à dire bien peu de choses. Nous nous concentrions sur notre petit univers. D'ailleurs, que pouvions-nous faire d'autre? Comme la majorité des gens, nous subissions!
La tonne de pommes de terre achetée au noir en octobre 43 avait déjà bien diminué dans la cave mais serait-elle suffisante pour faire la soudure avec la récolte du champ que l'on cultivait à la colline ?(...)
Le printemps est là, les jours s'allongent, on sent déjà l'été. Le débarquement a eu lieu, la guerre se déroule sur le sol français. Nous suivons tant bien que mal les événements. Nous apprenons par les voisins le drame d'Ouradour sur Glane.
Notre petite ville a été secouée dans les premiers jours de juillet par une rafle éclair des Allemands qui, un soir ont ramassé les hommes qu'ils trouvaient sur leur chemin, dont un bien inoffensif qui prenait l'air devant sa porte, cela sous les yeux de sa femme, sa fille et sa belle mère et l'ont déporté sans autre forme de procès.
C'est aujourd'hui le 14 juillet, je vais au centre ville ce matin, peut être qu'un ou deux magasins seront ouverts. Je rapporterai ce que je pourrai y trouver et peut être même rien du tout.
Nous sommes cinq ou six à déambuler dans la Grande Rue, bien que les magasins ne soient pas ouverts, quand débouchent, de Chaillon, près de la maison brûlée Munsch, un commando de FFI, en tenue kaki et armés de mitraillettes.
A leur vue, nous nous sommes entassés dans l'entrée de la coopérative ouvrière. Sans un mot, les hommes ont formé les rangs et toujours en silence, la mitraillette en position de tir, ont défilé jusqu'au monument aux morts, près de l'église, où ils ont déposé la gerbe de fleurs que portait l'un des leurs.
« Si les Allemands arrivent! » avons nous pensé. Et c'est plus morts que vifs que nous nous sommes empressés de partir, après leur passage, et chacun de notre côté. J'ai été vite rentrée à la maison!
Cela a été la plus belle peur ressentie pendant toute la guerre.
En août, le débarquement en Provence n'a pas arrangé les choses et il valait mieux rester en dehors de tout attroupement de toute sorte.
En août 1944, j'ai eu des congés, ma marraine m'a prise quelques jours chez elle à Saulxures sur Moselotte. Je m'y suis rendue à bicyclette. Marraine a tenu à me garder une journée de plus, heureusement, parce que la veille, les Allemands ont arrêté et déporté toutes personnes circulant sur la route de Cornimont, laquelle constituait mon itinéraire de retour à la maison.
C'est septembre, les vacances scolaires se prolongeront encore longtemps cette année. Les enfants ne s'en plaignent pas, ils prennent la vie comme elle vient sans se poser de question.
En septembre, nous sommes allés, papa et moi, un dimanche matin à la colline pour arracher quelques pieds de pommes de terre. En plein travail, nous avons entendu des avions au dessus de nous, sans y prêter trop attention. Il en passait tellement maintenant, nous avons simplement continué notre travail, mais pas longtemps!
Le tir d'une mitraillette juste sur nos têtes nous a plaqués au sol. Deux avions se battaient à quelques mètres, juste au dessus de nous. Le combat n'a pas duré longtemps, l'avion touché est parti en direction de St Maurice. Nous n'avons jamais su l'identité du vaincu. C'était la première fois que nous assistions à un combat aérien et nous avons eu très peur. Depuis la ferme, Alice avait vu, elle aussi et croyait que nous étions touchés, elle en tremblait d'émotion.
Nous avons retrouvé des éclats au bord du champ et l'avions échappé belle! (...)
Pendant la nuit du 25 au 26, les premiers obus tombent sur le Thillot. Le lendemain, dans la journée, cela recommence. On vise le clocher où, par définition se cache un guetteur allemand bien sûr. Hélas, des personnes habitant près de l'église, réunies près de leur maison sont touchées. Un homme, père de quatre enfants et une femme plus âgée sont tués. La femme du mort est blessée elle aussi. Un autre homme est sérieusement blessé deux jours plus tard quand les Allemands font sauter un pont sur la Moselle.
C'est le commencement des combats sur le secteur Ramonchamp – Bussang tandis que Rupt Sur Moselle est libéré.
Les Allemands tiennent encore le Thillot, cela durera deux mois. Nous sommes coupés de tout. Les usines, ateliers, bureaux sont fermés. Les premières personnes quittent leurs maisons et passent « les lignes », vers le Ménil. Les rassemblements sont interdits et quand nous allons à la boulangerie, sans savoir s’il y aura du pain, il faut raser les murs. Le canon tonne sans arrêt.
Un après midi, papa va jusqu'à la Grande Rue pour essayer de glaner quelques nouvelles. Il est presque revenu à la maison lorsqu'un obus rase sa tête pour éclater beaucoup plus loin.
Il nous a dit en rentrant : « Ne riez pas, mais je n'ai jamais fais aussi vite pour me mettre à plat ventre. »
Après cette journée, toute la cité a décidé de dormir dans les caves. Papa a aménagé la plus grande en dortoir. Quelques planches par dessus le casier à pommes de terre sont devenues le lit de mes parents. D’autres planches sur le coin du charbon feront le lit des filles. Sur le plus petit casier se trouvera le lit des garçons puisque l’aîné était parti pour s'engager dans la 2ème DB.
Lorsqu'il fallait chercher des légumes rentrés pour l'hiver ou du charbon, c'était un véritable gymkana. Ce n'était pas trop grave puisque nos journées se passaient encore à l'air libre.
Dans l'autre cave, c'était le coin des lapins logés dans cinq ou six clapiers.
Au petit matin, les odeurs de respiration de douze personnes, plus l'odeur des lapins plus celles du seau hygiénique faisaient que la remontée vers la cuisine était plutôt appréciée et que personne ne traînait au lit plus longtemps que nécessaire.
Les deux larmiers de cave, largement ouverts tout au long de la journée, renouvelaient l'air pour la nuit suivante.
Les combats duraient toujours, nous étions pris en tenaille, entre les soldats français positionnés à Rupt Sur Moselle et les Allemands placés sur les dessus de la Haute Saône en protection de l'Alsace qu'ils voulaient garder coûte que coûte. Si les tirs n'arrêtaient pas, peu d'obus tombaient, sauf hélas cet après midi ensoleillé d'octobre où les enfants jouaient dehors. Aux cités de la Courbe, un obus est tombé et a tué trois enfants, (un garçonnet, sa sœur et une autre fillette).
Ce jour, presque à la même heure, une femme et son fils qui revenaient des hauts du Thillot, côté Haute Saône, se mirent à l'abri dans les troènes plantés devant l'hôtel des Vosges.
« Maman, mets-toi vers la maison » dit le gamin. C'est à ce moment là qu'un obus fusant a éclaté au dessus de lui, le tuant sur le coup. Il avait treize ans et son papa était prisonnier. Un petit mongolien, présent également sur place n'a rien eu.
A cette même période, un autre garçon de quatorze ans qui faisait la navette, lignes françaises - lignes occupées a sauté sur une mine posée à proximité des lignes, (Certains ont dit que c'étaient les Allemands qui lui avaient tiré dessus). Lorsque les soldats français l'ont ramassé il n'a pu que leur dire « Ho! La belle dame que je vois ».
Si je raconte tout cela, c'est que tout deux venaient à la maison assez souvent, ils étaient camarades de mon frère Antoine et les parents, amis de notre famille. (...)
Vers la fin octobre, mon cousin est venu à la maison pour demander à mes parents s'il pouvait quelquefois emmener des gens pour passer la nuit à la maison. Ils arriveraient assez tard et repartiraient assez tôt le lendemain. Sans demander plus d'explication, la réponse a été « oui ». C'est ainsi que plusieurs fois, nous avons eu la visite de personnes de Bussang, St Maurice et même Fresse, qui ont passé quelques heures au chaud, à dormir sur un banc ou les coudes posés sur la table, avant de repartir pour passer les lignes au Ménil. Le matin, je faisais du café pour tout le monde et ils partaient revigorés dans l'aube bien frisquette. Cela, aucun voisin ne l'a su, même les petits n'en parlaient pas.
Il n'y a pas longtemps, Jacqueline, (elle avait dix ans à l'époque) m'a dit « Il était gonflé Robert, s'il avait été vendu, chez nous, on aurait casqué aussi ».
Tous s'étaient bien rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas une chose à raconter.
Nous voici aux environs de la Toussaint. Les tirs continuent, surtout du côté français de Ramonchamp. Il fait encore beau, bien que frais. Il va être midi, nous allons nous mettre à table. Les tirs se suivent et se rapprochent. Un homme, que nous connaissons, revient de Fresse où sont enterrés ses parents, quand, à la hauteur de la maison, et devant l'intensité des tirs, il s'arrête chez nous.
Les enfants, affolés, prennent chacun leur assiette, leurs couverts et descendent à la cave. Le monsieur, pas rassuré lui non plus, s'empare de la marmite de soupe sur la cuisinière et suit le mouvement. Il s'agit du premier jour où nous avons dû manger à la cave.
Peu de jours après, les hommes ont dû aller travailler pour les Allemands. Ils devaient faire des tranchées dans les bois de Chaillon. Ils emmèneraient à manger le matin et ne reviendraient que l'après midi. Ceux qui n'iraient pas seraient fusillés. (Je situe cet événement à cette époque, d'autres le pensent plus tôt, mais je sais que papa est parti très peu de temps après et qu'il n'y était pas allé longtemps. En effet, Mr Georges Grosjean, patron des tanneries, a prévenu assez tôt que les hommes allaient être déportés et beaucoup sont partis avant. Papa était de ceux là. Quelqu'un leur ferait passer les lignes, c'est tout ce qu'il savait.)
Papa avait simplement pris une musette où il avait glissé une paire de chaussettes, un morceau de pain et du fromage. S'il était pris, il ne fallait pas qu'il ait l'air de quitter son domicile. Il s'était tout de même mis deux épaisseurs de sous-vêtements.
Avant de prendre le départ, il m'a prise à l'écart pour me recommander: « Prends soin de maman et des autres, je vais aller chez Barbe. Il s'agissait de sa cousine qui habitait Vagney, village qui était libéré depuis le mois de septembre.
Nous n'avons pas été séparés longtemps puisque deux jours après, les 10 et 11 novembre nous étions évacués. Une trêve avait été accordée et nous avions du vendredi midi au samedi à 17h00 pour permettre l'évacuation totale du Thillot. Après cette date, les personnes trouvées à cet endroit seraient emmenées en Alsace.
A l'annonce de la nouvelle, maman a fondu en larmes. Que faire? Où aller? Où était papa? Pourtant, il a bien fallu qu'on organise ce départ. Avec des taies d'oreillers, j'ai confectionné des sortes de sacs à dos pour les cinq enfants âgés de huit à quatorze ans. J'y ai glissé du linge de rechange pour chacun d'eux et le leur ai posé sur les épaules. Les plus petits se donneraient la main aux côtés de maman qui porterait de quoi manger. Il n'y avait pas grand chose, tous les magasins étaient fermés, mais il y avait tout de même de quoi faire un repas.
J'ai enfilé un pantalon de mon frère aîné. Je portais un sac à dos bien rempli et Antoine aussi.
Nous nous étions entendus avec des voisins qui avaient de la famille au Ménil et partirions ensemble jusque là.
Nous n'étions guerre rassurés. Il fallait tout laisser sur place, que retrouverions-nous à notre retour ?
Monsieur Côme n'avait pas voulu partir les jours précédents avec les hommes. Maintenant, si les Allemands l'arrêtaient, que ferions-nous? Le problème a été résolu, du moins en partie, il a tout simplement mis des vêtements de sa femme et s'est maquillé, comme beaucoup d'autres.
Leur fille ne comprenait pas cette mascarade et pouvait à tout moment vendre la mèche en l'appelant papa. Nous avons mêlé la gamine avec les jeunes de chez nous et sa maman la surveillerait étroitement.
Tout s'est bien passé, il a fallu marcher en file indienne dans les prés et sans dévier car c'était truffé de mines.
Un couple qui était retourné dans leur maison après notre passage a sauté sur une mine en repassant dans la soirée. Ils sont morts tout les deux.
Une fois arrivés au Ménil, nos voisins sont allés dans leur famille, mais nous, qu'allions-nous faire? Nous avons mis plus de trois heures à faire quatre kilomètres et la nuit tombait vite. La neige fondait et tournait en gadoue sur la route.
La famille de nos voisins a proposé de garder les enfants, le temps que nous cherchions un refuge pour la nuit. Ils ne pouvaient nous garder tous.
« Il faut aller plus haut, vous trouverez sûrement » me dirent ils sans plus d'explications.
J'ai fait promettre aux enfants de ne pas bouger et je suis partie avec maman.
A peine à la sortie du village, notre bon ange était avec nous, nous avons rencontré mademoiselle Maritano, l'infirmière de la Tannerie Grosjean qui nous a indiqué un lieu sûr à plus d'un kilomètre.
« Allez y maintenant, j'en viens, il y a de la place, vous direz combien vous êtes et vous retournerai chercher les enfants » nous dit elle.
C'est ce que nous avons fait tandis que nos voisins sont restés dans leur famille. Après les avoir tous remerciés, j'ai remis les sacs sur les épaules des enfants et sommes partis pour arriver chez « Noni », à la nuit noire, vers 19 heures.
Peu après nous, arrivaient de St Maurice, de Fresse, de Bussang, par d'autres chemins des hommes habillés en femmes. Ils fuyaient les Allemands eux aussi. Ils avaient un moral de fer, ont bavardé et raconté des histoires toute la nuit.
Nous nous sommes restaurés, seuls les petits ont dormi, après leur demi-journée de marche, d'un sommeil de plomb tandis que nous autres avons plutôt sommeillé.
A six heures, tout le monde était debout, le passeur, monsieur Noni Chevrier nous attendait pour sept heures avec sa charrette et ses bœufs.
Après une louche de café et de lait chaud pour tout le monde, nous nous sommes mis en route. Nous avons pris en chemin d'autres évacués et des habitants du village. Le chariot emmenait les bagages, il y avait de tout. Nous étions une longue file à suivre.
« Attention, à certains endroits, il y a des mines, je vais les éviter » nous dit notre conducteur.
Quatre des hommes qui avaient passé la nuit dans notre refuge se sont relayés pour porter mes deux petites sœurs, Annette, deux ans et demie et Josette, trois ans et demie. Gisèle et Michel, cinq et six ans seront portés eux aussi, mais occasionnellement. Monique, Rosine, Jean , Jacqueline, respectivement huit, neuf, dix et onze ans ont comme nous tous marché, marché, marché, pendant plusieurs kilomètres, dans la neige fondue par un froid hivernal, chaussés de souliers aux semelles bien amincies. Je ne me souviens pas de les avoir entendus se plaindre. Antoine m'aidant à ne pas les perdre dans la colonne humaine qui montait vers le col de Morbieux. Nous leur avions dit que nous trouverions les Français en haut du chemin.
Tout à coup, ça y est, les premiers de la file les voient! Ils sont là ! La fatigue ne compte plus, nous sommes enfin arrivés!
Je vois encore cet homme, tout ému qui donne une poignée de main aux premiers militaires aperçus avec ces mots : « Bonjour la France! ».
Photo debacle homme qui sert la main
Je vois encore Antoine, bouche bée, devant des soldats noirs qui rient. Sa première surprise passée, il fait le geste, doigts pliés devant la bouche, pour demander à manger.
Le soldat blanc qui était avec eux lui a dit gentiment : « Tu peux leur demander, tu sais, ils parlent français comme toi ».
Ils nous ont emmenés dans leur abri et nous a donné du pain blanc, du chocolat et d'autres choses dont je ne me souviens plus.
Et puis il a fallu repartir. Chacun a repris, qui ses sacs, qui ses valises et nous sommes arrivés dans une clairière, à combien, je ne saurais le dire.
Il y avait là ceux, qui comme nous, venaient du Ménil, ceux du Thillot, ceux de Ramonchamp, tous les premiers partis de la veille.
Nous étions en quelque sorte, la première fournée des évacués de ces deux jours là. Cela a duré jusqu'après dix sept heures.
Un chef militaire (je ne connais pas les grades) a évalué le troupeau et réparti chaque famille par groupes de deux ou trois, selon le nombre de personnes, dans chaque camion, et nous voilà en route.
« Pour où » ai-je demandé à un garçon assis en face de moi. J'étais totalement désorientée, je ne connaissais pas l'endroit.
« A Remiremont, après on sera évacué plus loin» m'a t il répondu.
En cours de voyage, il m'a semblé reconnaître certains paysages, mais sans approfondir plus avant.
Nous voici à Remiremont, au Centre d'Accueil, où doit s'effectuer la répartition des lieux d'évacuation.
Des jeunes femmes ont pris les petits sous leurs ailes, pendant les formalités d'enregistrement (nom, prénom, adresse, et toute la suite). Nous donnions, maman et moi, les renseignements demandés lorsqu’une fille arrive et demande à qui appartient la fillette qu'elle porte. « Elle a les pieds gelés » dit elle.
Maman s'effondre, c'est ma sœur Jacqueline. Bien sûr, les gelures ne sont pas profondes, mais on aura du mal à la rechausser ! Jacqueline s'est ressentie de ces gelures, pendant de nombreuses années, dès les premiers froids.
C'était la conséquence de la marche dans la neige, la veille et toute la matinée.
A ce moment-là, ma décision est prise. Nous irions à Vagney et nulle part ailleurs.
J'ai eu beaucoup de mal à convaincre l'employée que papa nous y attendait et que nous n'avions rien à faire en Haute Marne où elle voulait nous envoyer.
De guerre lasse, elle a mis le dossier de côté en me disant que je me débrouille seule.
Si je n'avais rien trouvé pour la nuit, nous partirions.
J'ai installé maman et les enfants dans un coin de la salle et je suis sortie. Où commencer? A qui m'adresser? Je n'en savais absolument rien quand j'ai vu un militaire avec des papiers à la main.
Je lui ai demandé comment je pouvais aller à Vagney, lui ai dit que nous venions du Thillot, que maman était fatiguée, que ma petite sœur avait les pieds gelés, en un mot je lui ai dit « tout le paquet », et que Papa nous attendait à Vagney, ( Vagney que nous avions traversé pour nous rendre de Morbieux à Remiremont). Je lui ai précisé que si les camions repassent par là pour aller chercher d'autres évacués, ils pourraient nous déposer à Vagney.
« Les derniers convois sont déjà repartis. Ceux qui se préparent partent sur Rochesson » me répondit-il.
« Rochesson! Mais c'est justement Route de Rochesson que demeurent les cousins de papa » m'écriais-je.
« Voilà les camions, si deux chauffeurs veulent vous emmener à vos risques et périls, allez-y » me dit-il. Il m'a fallu moins de temps pour convaincre deux jeunes soldats, mais comme ils étaient prêts à partir, je devais aller chercher toute la famille en vitesse.
J'ai récupéré tout mon monde et ai lancé en passant devant le bureau : « Nous allons à Vagney ».
Nous y sommes arrivés vers dix huit heures, à l'heureuse surprise de papa et des cousins.
Papa était rentré depuis une demi-heure selon Barbe. Il était allé faire un tour au village et avait vu passer des camions pleins de gens du Thillot. Devant le nombre, il avait compris qu'il s'agissait d'une évacuation totale et se demandait où nous pouvions être.
Quelle joie de nous retrouver enfin réunis !
Les personnes âgées, invalides de l'hospice du Thillot ont été emmenées à Bussang par les Allemands.
Il était dix huit heures, la trêve était finie et les combats ont repris de plus belle.
De cette période de la guerre, il y a eu une quantité disparate d'anecdotes et de souvenirs. Chacun a raconté à sa façon ce qu'il a vécu. Ce n'était pas toujours conforme à la version de son voisin. Les mêmes événements ont été ressentis différemment par chacun, selon leur importance et par rapport à l'individu qui l'a subi. D'où cette disparité malgré l'authenticité de chaque événement.
Le lendemain de notre arrivée, nous avons appris, (par qui? Comment? Allez savoir!) que le convoi suivant le nôtre, au Ménil, était passé sur une mine. Un monsieur italien, que nous connaissions a été tué et une femme blessée.
Merci encore à Barbe et Jean Beretta qui nous ont accueillis, sans jamais nous laisser, même supposer que nous les embarrassions.
Nous étions plusieurs familles du Thillot chez des parents ou amis sur Vagney.
Papa et moi, sommes partis un matin, ce devait être le 28 ou 29 novembre. Le Thillot venait d'être libéré. Notre but était d'y aller en reconnaissance pour faire l'état des lieux avant d'y ramener la famille.
J'avais fais un rêve peu de temps avant. Je voyais des trous d'obus tout autour de la maison mais elle avait toujours le toit.
Nous nous sommes retrouvés à cinq, dont une femme du Thillot avec son petit garçon, sur la route de Dommartin Les Remiremont, en direction de Vecoux.
Au bout de quelques kilomètres, une Jeep nous a croisés et le chauffeur s'est arrêté. Il pouvait prendre deux passagers. D'un commun accord, nous avons désigné Mme Georges et son fils.
Il faisait beau et le chemin à parcourir ne nous faisait pas peur. Nous avions tout notre temps.
Nous arrivons à la maison vers midi. Ironie du sort, j'ouvre les volets et voilà que passe un convoi de militaires, c'était une partie de ceux qui logeaient dans la maison que nous venions de quitter à Vagney alors que nous venions de parcourir presque quarante kilomètres à pied.
Le toit de notre maison était presque intact, il ne manquait que quelques tuiles que nous avons vite remplacées. Il nous en restait dans un coin du grenier. L'intérieur des pièces n'avait pas souffert, mais il y avait des trous dans le mur intérieur de la cave, côté buanderie, et des débris tout autour. Était-ce un morceau de l'obus éclaté dans la cour? Ou un obus à bout de course? Nous n'avons pas cherché à comprendre. Il a fallu tout nettoyer et aussi sortir les cadavres des lapins de leurs clapiers.
Nous n'avions plus de vaisselle, nous avons retrouvé des couverts dans les pièces du dernier étage, près du grenier. (Ces pièces n'étaient pas à nous). Qui les avait déposés là ? Mystère ! (...)
Plus tard, du fait que René, l'ainé, était militaire, nous avions une pièce vide et mes parents ont logé, à plusieurs reprises, pour une nuit ou deux, des soldats de passage. Il y avait beaucoup de va et vient parmi eux. Des soldats cantonnaient dans une grange près de chez nous. Ceux qui dormaient une nuit dans la grange s'arrangeaient toujours pour dormir la nuit d'après dans un endroit plus chaud, chacun leur tour et personne ne leur refusait. (...)
La guerre continue, le froid, la neige aussi. Les usines reprennent le travail, cahincaha et nous voici à Noël. Un Noël joyeux et triste à la fois.
Ma tante tient un café, elle avait des pensionnaires avant la guerre, surtout des ouvriers italiens, et loge maintenant des soldats. Ils font leur popote dans la buanderie et aiment venir dans la salle de café pour discuter, lire, écrire et jouer aux cartes, ou tout simplement se reposer près du poêle chauffé à blanc. Les clients sont pour ainsi dire inexistants.
Pour le réveillon, les soldats ont invité ma tante et sa famille à partager le leur. Nous avons passé une bonne soirée sans oublier ceux qui se battaient et ceux qui se trouvaient derrière les barbelés.
Ma tante et moi sommes allés à la messe de minuit. Quelle ferveur cette nuit-là à l'église. Le premier Noël libre depuis quatre ans.
Le travail a repris normalement depuis janvier 1945. La municipalité a monté des baraquements en bois dans la cour de la mairie pour remplacer les écoles qui avaient souffert des bombardements. Les enfants sont donc retournés en classe.
Les premiers mois de l'année se sont déroulés comme les précédents, dans l'attente de la fin de la guerre. Les troupes avançaient en Allemagne, mais nous n'en savions pas plus.
Nous avons reçu des nouvelles de mon frère. Il était en Allemagne avec la 2ème DB du maréchal Leclerc.
L'hiver très rigoureux dure jusqu'en mars. Les restrictions continuent. Maman est de plus en plus malade. Nous ne le savions pas, mais elle attendait un bébé.
Elle essayait de faire ce qu'elle pouvait, mais avec une jambe toute enflée, elle ne pouvait guère tenir debout. Le docteur, de peur de suites fâcheuses, a immobilisé sa jambe dans une gouttière (armature de fer) pour une période de deux mois. Maman a dû rester couchée, elle avait une phlébite.
C'est pendant le temps de sa maladie que j'ai appris à faire mes premières tartes.
Voici le 8 mai qui nous annonce la victoire conjuguée des troupes et la fin de la guerre. L'Allemagne a capitulé.
C'est la liesse dans toute la France. Ce soir-là, Denise et moi avons eu la permission de sortir pour retrouver tous les jeunes. Nous avons pris en passant Simone qui venait aussi. Nous voilà sur la place du Ménil, il y a déjà là beaucoup de monde.
Jeunes, moins jeunes et même âgés, tous sont sortis, même quelques femmes de prisonniers.
« Enfin, nos maris vont rentrer et ce sera comme avant » disent-elles.
Ça grouille de monde, ça danse, chante et rit. Nous nous agrippons à une farandole et l'on crie comme les autres. Nous ne savons pas danser, mais quelle importance. On se dandine, saute à l'unisson. (...)
Je m'en étais donné à cœur joie, à tel point que le lendemain, en me levant, impossible d'émettre un son. Je me suis payée une extinction de voix pendant quatre jours ! (...)
C'est ainsi que « mère Blaise » annonce les changements du gouvernement en ces termes : « Le cabinet est renversé » .... puis un peu plus tard, ... « un nouveau cabinet est formé ».
Le lendemain, les mêmes propos reviennent, et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Les uns hochent la tête, les autres palabrent. Nous les jeunes, nous n'y comprenons rien, et on s’en moque.
Même le jour de la déclaration de guerre, nous ne nous inquiétons pas, bien des adultes aussi.
Les hommes sont graves, les femmes pleurent, les enfants dont les pères sont mobilisables en sont presque fiers et considèrent de haut ceux dont le père restera à la maison.
De toute façon, disent ils, les Boches seront bientôt battus.
Cela deviendra un refrain, pour eux et pour hélas beaucoup d'autres.
Voilà donc la guerre déclarée contre l'Allemagne. Pour bien des gens, cela ne change pas grand chose. Le travail continue. Les soldats viennent en permission, repartent et laissent bien souvent, sans le savoir, un bébé « mis en chantier » pendant la durée de leur séjour en famille. C'est ainsi que bien des enfants et des papas ne se connurent que cinq ans plus tard, ou ne se connurent pas du tout.
Il fallut camoufler toute source de lumière dès la nuit tombée (ordre de la défense passive). Nos fenêtres n'avaient pas de volets, alors maman a teint de vieux draps en bleu foncé que nous accrochions tous les soirs d'automne et d'hiver. L'un de nous sortait afin de regarder si aucune lumière ne passait ! Nous ne pensions pas du tout aux restrictions, la France était si riche.
Notre année scolaire a commencé par un discours de madame la Directrice et avec quelques élèves supplémentaires, des Parisiens, envoyés par des parents prévoyants dans leur famille thillotine et aussi quelques Alsaciens. (...)
L'année 1940 a commencé dans la morosité pour tous. (...) En avril, je suis allée à l'hôpital à Nancy pour quelques jours. Je devais être opérée des amygdales et des végétations. J'étais âgée pour cette opération et le médecin de famille avait préféré m'envoyer aussi loin ! (...)
Au retour, le train était bondé de soldats allant en permission, qui riaient, chantaient et chahutaient (surtout les jeunes), heureux de retrouver leur famille. Ce fut je crois les dernières permissions accordées.
Arrive le joli moi de mai, si joli cette année, et le dimanche de Pentecôte. Il faisait un temps superbe, chaud et ensoleillé. La nature elle aussi était en fête.
C'est le curé de la paroisse qui officiait. Mobilisé, il avait bénéficié d'une permission et nous a fait une belle cérémonie. Il a su nous dire, avec des mots simples, sa joie d'être parmi nous et son émotion de voir avec quelle ferveur s'étaient joints les parents et amis des enfants. Il a terminé en nous disant à tous, petits et grands, d'être braves et courageux pendant les temps à venir. Capitaine dans l'armée, il se doutait de ce qui allait suivre. Il a terminé son sermon (on dit homélie maintenant) par cette phrase qui a fait sourire toute l'assemblée: « Que personne ne fasse de péché de gourmandise dans aucun domaine! »
Ce n'était pas encore le temps des restrictions. (...)
Au 08 juin 1940, nous sommes encore allés en classe pendant quelques jours. Avec une camarade, nous enlevions les livres de classe pour les mettre à l'abri dans les caves de la mairie. C'est là, pendant une alerte que, réfugiées dans le couloir de la cave, nous avons vu deux messieurs, bien habillés, s'asseoir à la terrasse du restaurant de la mairie, et parler entre eux dans une langue que nous ne comprenions pas. C'était de l'allemand.
Hélas, la mairie et toutes les maisons de la place ont été brûlées par les Allemands lors de leur entrée au Thillot, y compris les livres de la classe mis à l'abri !
Je me souviendrai toujours de la date du 10 juin 1940, jour où j'ai vu pleurer papa. Le jour mémorable où Mussolini a déclaré la guerre à la France en s'unissant avec Hitler. Cela, papa ne l'a jamais admis, lui qui s'était déjà battu en 1917 avec les Français. Il ne comprenait pas la désaffection de l'Italie.
C'est peu après qu'il a pris la route avec beaucoup d'autres, pour s'éloigner des Allemands qui arrivaient. Au bout de deux jours, il avait parcouru une centaine de kilomètres. Devant la pagaille qu'il voyait sur la route, il a pensé qu'il serait aussi bien à la maison avec nous, et a rebroussé chemin. Songez à notre joie quand nous l'avons revu. Il avait marché jusqu'à Gray, en Haute Saône.
Les soldats français se retiraient de la zone alsacienne et ont cantonné près de chez nous. Il y en avait partout dans les cours, autour des maisons et dans le parc en face de notre cité. Ils y avaient monté une batterie de mitrailleuse. Quand le soir est arrivé, il a fallu trouver où loger ces hommes. Nous n'avions pas de place, mais mes parents ont laissé la porte de la cuisine ouverte et quelques uns sont venus y dormir. Les chaises étaient mises sur la table pour faire de la place. Le lendemain matin, tous étaient partis, mais avaient laissés en évidence, une boite de cinq kilos de sucre en poudre, en remerciement.
La batterie était toujours en place, eux restaient. Le capitaine qui commandait les hommes a prévenu les adultes. Que ceux qui le pouvaient partent dans un endroit plus calme dans les environs.
Nous avions des amis italiens habitant dans une ferme dans la montagne, à Chaillon, près du bois. Papa est parti aussitôt leur demander asile pendant que nous préparions quelques vêtements et victuailles. Sitôt son retour, nous sommes partis d'un bon pied, rassurés que nous ne risquions plus rien. Si nous avions su!
Tante Marie, sa maman et le pensionnaire (un homme âgé), sont venus avec nous. Le vieil homme avait emmené les quelques poules de ma tante dans un sac bien fermé, si bien fermé qu'une partie des bêtes étaient mortes étouffées à leur arrivée!
C'était en juin, en pleine saison des foins. La ferme se trouvait à flanc de montagne, faisant vis à vis, à quelques kilomètres de là, à d'autres fermes situées elles aussi à flanc de montagne, mais en Haute Saône.
Les deux premiers jours, tout fut calme, mais le troisième, quel changement! Les soldats cantonnés au Thillot résistaient aux troupes allemandes venant d'Alsace et à celles arrivées jusqu'au petit village Franc-Comtois de Château Lambert sis en haut de la cuvette dont le Thillot forme le fond.
Par conséquent les Allemands se trouvaient de l'autre côté de là où nous nous étions réfugiés. Nous ne le savions pas.
Les grands et petits fanaient, au cœur de l'après midi, le foin que les hommes avaient fauché le matin, afin de tout rentrer le soir.
Tout le monde vient de quitter le pré du haut pour une petite collation quand une pluie d'obus est tombée dans le pré qui venait d'être quitté. Grâce à cela, personne ne fût blessé mais le travail a été terminé pour le reste de la journée. Nous avons eu une fameuse frousse, vous pouvez le croire!
Les soldats allemands, depuis le promontoire comtois avaient remarqué une grande activité chez leurs vis à vis et en avaient conclu qu'il se tenait là une batterie qu'il fallait vaincre.
Personne n'a voulu passer la nuit dans la maison et nous sommes allés dans une grange indépendante située un peu en retrait de la ferme. Nous n'avons guère dormi tant la peur nous tenaillait en entendant les détonations. La bataille a duré toute la nuit.
Vers sept heures, le lendemain matin, des avions passant en rase motte ont lancé des tracts nous enjoignant de nous rendre, que la guerre était finie, qu'ils avaient gagné. C'était écrit en français et en allemand.
Des adultes, abattus, découragés, se sont concertés, les hommes âgés sont descendus vers la ville, chacun par un chemin différent, pour aller aux nouvelles. Quand papa est revenu, il nous a appris qu'il y avait d'énormes dégâts, les ponts avaient sauté, toutes les maisons de la place de la mairie étaient détruites. Le parc Beluche, où était la batterie, en face de chez nous, n'était plus qu'un terrain plein de trous. Les soldats s'étaient vaillamment défendus et avaient tous été tués, avec à leur tête le Capitaine Belhomme.
Papa a ajouté: « C'est une honte, il y a des gens qui volent dans les magasins dont les vitrines sont pulvérisées. Je me suis sauvé, de peur de reconnaître des personnes de connaissance ».
C'est je crois, ce qui l'a le plus choqué de cette première journée de défaite.
Nous sommes encore restés une journée à la ferme et avons retrouvé notre logement ainsi que nos voisins qui étaient restés sur place en vivant à la cave, et aussi ceux, qui comme nous, rentraient des environs. Des habitants étaient partis dès les premiers jours et beaucoup ont préféré rester là où ils étaient arrivés, pour s'établir définitivement, en zone libre, comme nous disions.
Pour nous, la guerre était terminée avec des soldats allemands cantonnés aux lieux et places des soldats français, une dizaine de jours auparavant. Nous avons eu droit à la parade et au défilé chantant tous les jours. Deux sentinelles étaient postées à l'entrée du parc, près de chez nous. Cela ne nous empêchait pas, nous les enfants, d'aller y jouer et nous défouler sans contrainte, surtout au début. Il y eu interdiction plus tard.
J'étais jeune et j'aimais chanter en travaillant dans la maison. Je passais facilement des cantiques aux chansons patriotiques que j'avais apprises pour le certificat d'études. J'aimais tout particulièrement “La Marseillaise” pour son rythme entraînant. C'est ainsi qu'un matin, trois ou quatre jours après la défaite, je chantais à tue-tête quand une voisine fait irruption dans notre cuisine, toute affolée: « Malheureuse! Tais-toi ! Si les Allemands t'entendent, tu peux être fusillée! Nous n'avons plus le droit de chanter ces chansons-là! Quelle peur tu m'as faite! ». dit-elle encore.
J'ai tout de suite compris la leçon. Je n'ai plus chanté pendant longtemps. Je pensais toujours à ce que m'avait dit Léa Marsot.
Les Allemands avaient installé une « popote » pour leurs soldats, dans la cour du marchand de charbon Laroche. Bien des enfants allaient quémander du pain en disant au cuistot : « Brot, Brot ». Nous allions aussi voir les soldats, mais ne leur avons jamais rien demandé. Le riz aux pruneaux ne nous tentait guère, et puis, nous avions déjà notre fierté!
Nous n'avions pas de poste TSF, ne savions pas grand chose des évènements, sauf ce qu'imprimait le journal. Ceux qui se tenaient au courant chuchotaient aux oreilles des adultes et prenaient des mines averties, dès que les enfants se joignaient à eux pour écouter.
Fin juin ou juillet, les Allemands nous firent changer d'heure pour s'adapter à l'heure allemande. Je crois que nous retardions d'une heure par rapport à eux. C'est à peu près à la même époque que les restrictions commencèrent à se faire sentir. Ce fut aussi le temps des premières queues devant les épiceries et boulangeries. Les boucheries un peu plus tard seulement.
Alors, tous les jours, (c’était le temps des vacances scolaires), dès sept heures du matin, je partais pour être dans les premières devant la porte de la boutique et avoir un numéro pour revenir à l'heure de l'ouverture. Maman disait: « Les premiers arrivés, les mieux servis ». Une fermière devant chez qui je passais tous les matins m'a demandé un jour si je travaillais. Elle me voyait passer tous les jours à la même heure, cela l'intriguait fortement.
Ce fut au début du mois de juillet que nous avons appris par une jeune femme, parente d'une de nos voisines, que la femme de mon parrain, « Tante Honorine », était décédée à l'hôpital d'Epinal. Elle avait été tuée par un éclat d'obus en cueillant des pois dans son jardin.
Cette jeune femme allait voir son mari blessé lors des derniers combats quand elle a vu sur un tableau d'affichage les noms des décédés de la veille. Comme elle connaissait le nom patronymique de maman, elle nous a prévenus dès son arrivée au Thillot. (...)
A la rentrée scolaire, j'entrais au cours complémentaire avec un maître ou une maîtresse pour chaque discipline. Certains faisaient deux cours de suite. Nous apprenions aussi une langue étrangère (l’allemand obligatoirement, bien sûre). La première année s'était passée facilement, comme au temps du primaire.
L'hiver 40/41 est arrivé, avec la force et la rigueur de notre région. La nuit, il fallait toujours camoufler les ouvertures. L'habitude était prise.
Un soir, je terminais mes devoirs quand on a frappé à la porte avec insistance et j'entendais un parlé rugueux. J'ai juste entrouvert la porte et me suis retrouvé nez à nez avec un soldat allemand. Au même moment, la voisine mitoyenne a ouvert chez elle. Tout est rentré bien vite dans l'ordre, le monsieur en question s'était tout simplement trompé de porte. Cela a duré paraît-il pendant toutes les années d'occupation, avec changement de partenaires, selon les départs et les arrivées de nouvelles troupes bien sûr. (...)
L'année 1941 a passé, comme la précédente avec les restrictions, les cartes d'alimentation, de vêtements et de tabac, avec la peur (déjà) et la peine des familles des prisonniers.
La résistance, composée de civils, commençait à pointer de ci de là tandis que les Allemands traquaient les Juifs. (...)
Mon oncle, démobilisé a été contraint, à la suite d'une histoire avec un Allemand, de partir travailler en Allemagne. Son fils, Lucien, démobilisé lui aussi, travaillait dans les fermes aux alentours d'Epinal. (...) Il a été lui aussi requis par le STO en septembre 1942. Pendant son séjour, il avait connu plusieurs jeunes gens qui recrutaient de futurs résistants. Il savait qu'il pouvait s'adresser à l'un d'eux en cas de « pépin ». Aussi, sans nous en parler, il avait pris contact avec celui qui lui avait laissé entendre qu'il savait où le loger au cas où... .
Il était revenu une fois en permission d'Allemagne, mais plutôt que de repartir, il était resté à Epinal où il s'est fait prendre.
L'année 1943 était commencée quand un jour, au bureau, je reçois un coup de téléphone de Robert. Il me disait: « Je vais partir pour un temps assez long. Que personne ne s'inquiète ».
Je n'y comprenais rien et il ne m'a pas donné plus d'explication. Aussi, quelle n'a pas été notre surprise, quelque temps après, lorsqu'une lettre est arrivée à la maison, me convoquant à la Kommandantur à Epinal. Maman m'a accompagnée. Je peux vous dire que je n'en menais pas large! Nous fûmes reçues par un subalterne qui voulait connaître l'adresse de mon cousin. Il me questionna sur ses occupations antérieures et du moment. Je lui ai répondu que depuis son coup de téléphone de telle date nous étions sans nouvelle mais que nous ne nous faisions pas de soucis puisqu'il nous avait dit qu'il serait absent très longtemps. Cela a dû satisfaire l'Allemand puisqu'il nous a laissées repartir sans autres questions. Il n'y a pas eu de suite à cette convocation.
Nous avons su par la suite, les circonstances de son arrestation. Il revenait à la maison quand « ramassé » à la gare, avec d'autres jeunes gens, il n'a rien dit pour ne pas rendre mes parents suspects et a demandé à me téléphoner, (un policier en civil avait l'écouteur). Ce fut forcément assez bref, après quoi tous ont été embarqués sans explication dans un train en partance, mais pas dans la direction prévue par chacun.
Mon cousin avait pris toutes ses affaires et était aussi chargé qu'un baudet avec son énorme sac à dos ... c'est ce qui lui a permis de faire évader et s'évader lui même les quatre jeunes gens qui étaient dans la même situation que lui. Ils ont réussi à sauter du train et à s'évanouir dans la nature. Je crois qu'un seul s'est blessé en tombant. Robert obstruait le couloir grâce au volume de son sac à dos tandis que les autres pouvaient ouvrir la portière et sauter sur le ballast.
J'ai revu Robert récemment, il m'a confirmé cette version en ajoutant que seuls lui et le jeune blessé se sont sortis de cette aventure.
Et puis, un soir de printemps, après le passage de l'autorail (nous habitions en bordure de la voie ferrée Epinal – Bussang) qui voyons nous arriver ? Robert. Il nous a raconté ses péripéties et a dit qu'il devait aller dans une ferme, chez Madame Alice, à la colline de Fresse. Nous avons dressé l'oreille, (quand je dis nous, il s'agit de mes parents et moi) car nous allions chez cette personne pour acheter des fromages. Elle nous avait même cédé un champ qu'elle ne cultivait plus, faute de bras pour le faire. Papa l'avait planté en pommes de terre.
Mon père a donc été tout de suite d'accord pour emmener mon cousin dès la nuit tombée, Il est revenu dans le milieu de la nuit et a repris son travail normalement. Personne n'a jamais connu le récit de ce voyage nocturne. Mon cousin faisait son travail dans cette ferme et si le soir il s'égaillait et rentrait avant le point du jour, personne ne lui posait de question. Cela a duré jusqu'en 1944 où quelques patrouilles d'Allemands qui donnèrent des ennuis à certains, firent redoubler d'attention les maquisards, surtout après le débarquement.
Je me rappelle de ce jour où, montée avec papa pour butter les pommes de terre, nous étions assis avec Alice, en train de boire le café quand deux Allemands sont arrivés, le fusil à la bretelle. Ils ont eu droit, bien sûre à la tasse de café. C'étaient deux hommes d'une cinquantaine d'années, bien désabusés déjà. L'un avait l'ongle d'un pouce tout noir, un coup de marteau a-t-il dit.
« Quand mon ongle sera tombé et repoussé, cela va durer six mois, la guerre sera finie, ou presque » nous dit- il dans un français approximatif mais compréhensible. (...)
Nous entrons dans l'année 1944, l'hiver est toujours aussi rigoureux. La guerre continue, la résistance s'intensifie et la vie quotidienne va cahincaha. Chez nous, nous n'avions pas de TSF et ne connaissions des événements, seulement, ce que le journal publiait, c'est à dire bien peu de choses. Nous nous concentrions sur notre petit univers. D'ailleurs, que pouvions-nous faire d'autre? Comme la majorité des gens, nous subissions!
La tonne de pommes de terre achetée au noir en octobre 43 avait déjà bien diminué dans la cave mais serait-elle suffisante pour faire la soudure avec la récolte du champ que l'on cultivait à la colline ?(...)
Le printemps est là, les jours s'allongent, on sent déjà l'été. Le débarquement a eu lieu, la guerre se déroule sur le sol français. Nous suivons tant bien que mal les événements. Nous apprenons par les voisins le drame d'Ouradour sur Glane.
Notre petite ville a été secouée dans les premiers jours de juillet par une rafle éclair des Allemands qui, un soir ont ramassé les hommes qu'ils trouvaient sur leur chemin, dont un bien inoffensif qui prenait l'air devant sa porte, cela sous les yeux de sa femme, sa fille et sa belle mère et l'ont déporté sans autre forme de procès.
C'est aujourd'hui le 14 juillet, je vais au centre ville ce matin, peut être qu'un ou deux magasins seront ouverts. Je rapporterai ce que je pourrai y trouver et peut être même rien du tout.
Nous sommes cinq ou six à déambuler dans la Grande Rue, bien que les magasins ne soient pas ouverts, quand débouchent, de Chaillon, près de la maison brûlée Munsch, un commando de FFI, en tenue kaki et armés de mitraillettes.
A leur vue, nous nous sommes entassés dans l'entrée de la coopérative ouvrière. Sans un mot, les hommes ont formé les rangs et toujours en silence, la mitraillette en position de tir, ont défilé jusqu'au monument aux morts, près de l'église, où ils ont déposé la gerbe de fleurs que portait l'un des leurs.
« Si les Allemands arrivent! » avons nous pensé. Et c'est plus morts que vifs que nous nous sommes empressés de partir, après leur passage, et chacun de notre côté. J'ai été vite rentrée à la maison!
Cela a été la plus belle peur ressentie pendant toute la guerre.
En août, le débarquement en Provence n'a pas arrangé les choses et il valait mieux rester en dehors de tout attroupement de toute sorte.
En août 1944, j'ai eu des congés, ma marraine m'a prise quelques jours chez elle à Saulxures sur Moselotte. Je m'y suis rendue à bicyclette. Marraine a tenu à me garder une journée de plus, heureusement, parce que la veille, les Allemands ont arrêté et déporté toutes personnes circulant sur la route de Cornimont, laquelle constituait mon itinéraire de retour à la maison.
C'est septembre, les vacances scolaires se prolongeront encore longtemps cette année. Les enfants ne s'en plaignent pas, ils prennent la vie comme elle vient sans se poser de question.
En septembre, nous sommes allés, papa et moi, un dimanche matin à la colline pour arracher quelques pieds de pommes de terre. En plein travail, nous avons entendu des avions au dessus de nous, sans y prêter trop attention. Il en passait tellement maintenant, nous avons simplement continué notre travail, mais pas longtemps!
Le tir d'une mitraillette juste sur nos têtes nous a plaqués au sol. Deux avions se battaient à quelques mètres, juste au dessus de nous. Le combat n'a pas duré longtemps, l'avion touché est parti en direction de St Maurice. Nous n'avons jamais su l'identité du vaincu. C'était la première fois que nous assistions à un combat aérien et nous avons eu très peur. Depuis la ferme, Alice avait vu, elle aussi et croyait que nous étions touchés, elle en tremblait d'émotion.
Nous avons retrouvé des éclats au bord du champ et l'avions échappé belle! (...)
Pendant la nuit du 25 au 26, les premiers obus tombent sur le Thillot. Le lendemain, dans la journée, cela recommence. On vise le clocher où, par définition se cache un guetteur allemand bien sûr. Hélas, des personnes habitant près de l'église, réunies près de leur maison sont touchées. Un homme, père de quatre enfants et une femme plus âgée sont tués. La femme du mort est blessée elle aussi. Un autre homme est sérieusement blessé deux jours plus tard quand les Allemands font sauter un pont sur la Moselle.
C'est le commencement des combats sur le secteur Ramonchamp – Bussang tandis que Rupt Sur Moselle est libéré.
Les Allemands tiennent encore le Thillot, cela durera deux mois. Nous sommes coupés de tout. Les usines, ateliers, bureaux sont fermés. Les premières personnes quittent leurs maisons et passent « les lignes », vers le Ménil. Les rassemblements sont interdits et quand nous allons à la boulangerie, sans savoir s’il y aura du pain, il faut raser les murs. Le canon tonne sans arrêt.
Un après midi, papa va jusqu'à la Grande Rue pour essayer de glaner quelques nouvelles. Il est presque revenu à la maison lorsqu'un obus rase sa tête pour éclater beaucoup plus loin.
Il nous a dit en rentrant : « Ne riez pas, mais je n'ai jamais fais aussi vite pour me mettre à plat ventre. »
Après cette journée, toute la cité a décidé de dormir dans les caves. Papa a aménagé la plus grande en dortoir. Quelques planches par dessus le casier à pommes de terre sont devenues le lit de mes parents. D’autres planches sur le coin du charbon feront le lit des filles. Sur le plus petit casier se trouvera le lit des garçons puisque l’aîné était parti pour s'engager dans la 2ème DB.
Lorsqu'il fallait chercher des légumes rentrés pour l'hiver ou du charbon, c'était un véritable gymkana. Ce n'était pas trop grave puisque nos journées se passaient encore à l'air libre.
Dans l'autre cave, c'était le coin des lapins logés dans cinq ou six clapiers.
Au petit matin, les odeurs de respiration de douze personnes, plus l'odeur des lapins plus celles du seau hygiénique faisaient que la remontée vers la cuisine était plutôt appréciée et que personne ne traînait au lit plus longtemps que nécessaire.
Les deux larmiers de cave, largement ouverts tout au long de la journée, renouvelaient l'air pour la nuit suivante.
Les combats duraient toujours, nous étions pris en tenaille, entre les soldats français positionnés à Rupt Sur Moselle et les Allemands placés sur les dessus de la Haute Saône en protection de l'Alsace qu'ils voulaient garder coûte que coûte. Si les tirs n'arrêtaient pas, peu d'obus tombaient, sauf hélas cet après midi ensoleillé d'octobre où les enfants jouaient dehors. Aux cités de la Courbe, un obus est tombé et a tué trois enfants, (un garçonnet, sa sœur et une autre fillette).
Ce jour, presque à la même heure, une femme et son fils qui revenaient des hauts du Thillot, côté Haute Saône, se mirent à l'abri dans les troènes plantés devant l'hôtel des Vosges.
« Maman, mets-toi vers la maison » dit le gamin. C'est à ce moment là qu'un obus fusant a éclaté au dessus de lui, le tuant sur le coup. Il avait treize ans et son papa était prisonnier. Un petit mongolien, présent également sur place n'a rien eu.
A cette même période, un autre garçon de quatorze ans qui faisait la navette, lignes françaises - lignes occupées a sauté sur une mine posée à proximité des lignes, (Certains ont dit que c'étaient les Allemands qui lui avaient tiré dessus). Lorsque les soldats français l'ont ramassé il n'a pu que leur dire « Ho! La belle dame que je vois ».
Si je raconte tout cela, c'est que tout deux venaient à la maison assez souvent, ils étaient camarades de mon frère Antoine et les parents, amis de notre famille. (...)
Vers la fin octobre, mon cousin est venu à la maison pour demander à mes parents s'il pouvait quelquefois emmener des gens pour passer la nuit à la maison. Ils arriveraient assez tard et repartiraient assez tôt le lendemain. Sans demander plus d'explication, la réponse a été « oui ». C'est ainsi que plusieurs fois, nous avons eu la visite de personnes de Bussang, St Maurice et même Fresse, qui ont passé quelques heures au chaud, à dormir sur un banc ou les coudes posés sur la table, avant de repartir pour passer les lignes au Ménil. Le matin, je faisais du café pour tout le monde et ils partaient revigorés dans l'aube bien frisquette. Cela, aucun voisin ne l'a su, même les petits n'en parlaient pas.
Il n'y a pas longtemps, Jacqueline, (elle avait dix ans à l'époque) m'a dit « Il était gonflé Robert, s'il avait été vendu, chez nous, on aurait casqué aussi ».
Tous s'étaient bien rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas une chose à raconter.
Nous voici aux environs de la Toussaint. Les tirs continuent, surtout du côté français de Ramonchamp. Il fait encore beau, bien que frais. Il va être midi, nous allons nous mettre à table. Les tirs se suivent et se rapprochent. Un homme, que nous connaissons, revient de Fresse où sont enterrés ses parents, quand, à la hauteur de la maison, et devant l'intensité des tirs, il s'arrête chez nous.
Les enfants, affolés, prennent chacun leur assiette, leurs couverts et descendent à la cave. Le monsieur, pas rassuré lui non plus, s'empare de la marmite de soupe sur la cuisinière et suit le mouvement. Il s'agit du premier jour où nous avons dû manger à la cave.
Peu de jours après, les hommes ont dû aller travailler pour les Allemands. Ils devaient faire des tranchées dans les bois de Chaillon. Ils emmèneraient à manger le matin et ne reviendraient que l'après midi. Ceux qui n'iraient pas seraient fusillés. (Je situe cet événement à cette époque, d'autres le pensent plus tôt, mais je sais que papa est parti très peu de temps après et qu'il n'y était pas allé longtemps. En effet, Mr Georges Grosjean, patron des tanneries, a prévenu assez tôt que les hommes allaient être déportés et beaucoup sont partis avant. Papa était de ceux là. Quelqu'un leur ferait passer les lignes, c'est tout ce qu'il savait.)
Papa avait simplement pris une musette où il avait glissé une paire de chaussettes, un morceau de pain et du fromage. S'il était pris, il ne fallait pas qu'il ait l'air de quitter son domicile. Il s'était tout de même mis deux épaisseurs de sous-vêtements.
Avant de prendre le départ, il m'a prise à l'écart pour me recommander: « Prends soin de maman et des autres, je vais aller chez Barbe. Il s'agissait de sa cousine qui habitait Vagney, village qui était libéré depuis le mois de septembre.
Nous n'avons pas été séparés longtemps puisque deux jours après, les 10 et 11 novembre nous étions évacués. Une trêve avait été accordée et nous avions du vendredi midi au samedi à 17h00 pour permettre l'évacuation totale du Thillot. Après cette date, les personnes trouvées à cet endroit seraient emmenées en Alsace.
A l'annonce de la nouvelle, maman a fondu en larmes. Que faire? Où aller? Où était papa? Pourtant, il a bien fallu qu'on organise ce départ. Avec des taies d'oreillers, j'ai confectionné des sortes de sacs à dos pour les cinq enfants âgés de huit à quatorze ans. J'y ai glissé du linge de rechange pour chacun d'eux et le leur ai posé sur les épaules. Les plus petits se donneraient la main aux côtés de maman qui porterait de quoi manger. Il n'y avait pas grand chose, tous les magasins étaient fermés, mais il y avait tout de même de quoi faire un repas.
J'ai enfilé un pantalon de mon frère aîné. Je portais un sac à dos bien rempli et Antoine aussi.
Nous nous étions entendus avec des voisins qui avaient de la famille au Ménil et partirions ensemble jusque là.
Nous n'étions guerre rassurés. Il fallait tout laisser sur place, que retrouverions-nous à notre retour ?
Monsieur Côme n'avait pas voulu partir les jours précédents avec les hommes. Maintenant, si les Allemands l'arrêtaient, que ferions-nous? Le problème a été résolu, du moins en partie, il a tout simplement mis des vêtements de sa femme et s'est maquillé, comme beaucoup d'autres.
Leur fille ne comprenait pas cette mascarade et pouvait à tout moment vendre la mèche en l'appelant papa. Nous avons mêlé la gamine avec les jeunes de chez nous et sa maman la surveillerait étroitement.
Tout s'est bien passé, il a fallu marcher en file indienne dans les prés et sans dévier car c'était truffé de mines.
Un couple qui était retourné dans leur maison après notre passage a sauté sur une mine en repassant dans la soirée. Ils sont morts tout les deux.
Une fois arrivés au Ménil, nos voisins sont allés dans leur famille, mais nous, qu'allions-nous faire? Nous avons mis plus de trois heures à faire quatre kilomètres et la nuit tombait vite. La neige fondait et tournait en gadoue sur la route.
La famille de nos voisins a proposé de garder les enfants, le temps que nous cherchions un refuge pour la nuit. Ils ne pouvaient nous garder tous.
« Il faut aller plus haut, vous trouverez sûrement » me dirent ils sans plus d'explications.
J'ai fait promettre aux enfants de ne pas bouger et je suis partie avec maman.
A peine à la sortie du village, notre bon ange était avec nous, nous avons rencontré mademoiselle Maritano, l'infirmière de la Tannerie Grosjean qui nous a indiqué un lieu sûr à plus d'un kilomètre.
« Allez y maintenant, j'en viens, il y a de la place, vous direz combien vous êtes et vous retournerai chercher les enfants » nous dit elle.
C'est ce que nous avons fait tandis que nos voisins sont restés dans leur famille. Après les avoir tous remerciés, j'ai remis les sacs sur les épaules des enfants et sommes partis pour arriver chez « Noni », à la nuit noire, vers 19 heures.
Peu après nous, arrivaient de St Maurice, de Fresse, de Bussang, par d'autres chemins des hommes habillés en femmes. Ils fuyaient les Allemands eux aussi. Ils avaient un moral de fer, ont bavardé et raconté des histoires toute la nuit.
Nous nous sommes restaurés, seuls les petits ont dormi, après leur demi-journée de marche, d'un sommeil de plomb tandis que nous autres avons plutôt sommeillé.
A six heures, tout le monde était debout, le passeur, monsieur Noni Chevrier nous attendait pour sept heures avec sa charrette et ses bœufs.
Après une louche de café et de lait chaud pour tout le monde, nous nous sommes mis en route. Nous avons pris en chemin d'autres évacués et des habitants du village. Le chariot emmenait les bagages, il y avait de tout. Nous étions une longue file à suivre.
« Attention, à certains endroits, il y a des mines, je vais les éviter » nous dit notre conducteur.
Quatre des hommes qui avaient passé la nuit dans notre refuge se sont relayés pour porter mes deux petites sœurs, Annette, deux ans et demie et Josette, trois ans et demie. Gisèle et Michel, cinq et six ans seront portés eux aussi, mais occasionnellement. Monique, Rosine, Jean , Jacqueline, respectivement huit, neuf, dix et onze ans ont comme nous tous marché, marché, marché, pendant plusieurs kilomètres, dans la neige fondue par un froid hivernal, chaussés de souliers aux semelles bien amincies. Je ne me souviens pas de les avoir entendus se plaindre. Antoine m'aidant à ne pas les perdre dans la colonne humaine qui montait vers le col de Morbieux. Nous leur avions dit que nous trouverions les Français en haut du chemin.
Tout à coup, ça y est, les premiers de la file les voient! Ils sont là ! La fatigue ne compte plus, nous sommes enfin arrivés!
Je vois encore cet homme, tout ému qui donne une poignée de main aux premiers militaires aperçus avec ces mots : « Bonjour la France! ».
Photo debacle homme qui sert la main
Je vois encore Antoine, bouche bée, devant des soldats noirs qui rient. Sa première surprise passée, il fait le geste, doigts pliés devant la bouche, pour demander à manger.
Le soldat blanc qui était avec eux lui a dit gentiment : « Tu peux leur demander, tu sais, ils parlent français comme toi ».
Ils nous ont emmenés dans leur abri et nous a donné du pain blanc, du chocolat et d'autres choses dont je ne me souviens plus.
Et puis il a fallu repartir. Chacun a repris, qui ses sacs, qui ses valises et nous sommes arrivés dans une clairière, à combien, je ne saurais le dire.
Il y avait là ceux, qui comme nous, venaient du Ménil, ceux du Thillot, ceux de Ramonchamp, tous les premiers partis de la veille.
Nous étions en quelque sorte, la première fournée des évacués de ces deux jours là. Cela a duré jusqu'après dix sept heures.
Un chef militaire (je ne connais pas les grades) a évalué le troupeau et réparti chaque famille par groupes de deux ou trois, selon le nombre de personnes, dans chaque camion, et nous voilà en route.
« Pour où » ai-je demandé à un garçon assis en face de moi. J'étais totalement désorientée, je ne connaissais pas l'endroit.
« A Remiremont, après on sera évacué plus loin» m'a t il répondu.
En cours de voyage, il m'a semblé reconnaître certains paysages, mais sans approfondir plus avant.
Nous voici à Remiremont, au Centre d'Accueil, où doit s'effectuer la répartition des lieux d'évacuation.
Des jeunes femmes ont pris les petits sous leurs ailes, pendant les formalités d'enregistrement (nom, prénom, adresse, et toute la suite). Nous donnions, maman et moi, les renseignements demandés lorsqu’une fille arrive et demande à qui appartient la fillette qu'elle porte. « Elle a les pieds gelés » dit elle.
Maman s'effondre, c'est ma sœur Jacqueline. Bien sûr, les gelures ne sont pas profondes, mais on aura du mal à la rechausser ! Jacqueline s'est ressentie de ces gelures, pendant de nombreuses années, dès les premiers froids.
C'était la conséquence de la marche dans la neige, la veille et toute la matinée.
A ce moment-là, ma décision est prise. Nous irions à Vagney et nulle part ailleurs.
J'ai eu beaucoup de mal à convaincre l'employée que papa nous y attendait et que nous n'avions rien à faire en Haute Marne où elle voulait nous envoyer.
De guerre lasse, elle a mis le dossier de côté en me disant que je me débrouille seule.
Si je n'avais rien trouvé pour la nuit, nous partirions.
J'ai installé maman et les enfants dans un coin de la salle et je suis sortie. Où commencer? A qui m'adresser? Je n'en savais absolument rien quand j'ai vu un militaire avec des papiers à la main.
Je lui ai demandé comment je pouvais aller à Vagney, lui ai dit que nous venions du Thillot, que maman était fatiguée, que ma petite sœur avait les pieds gelés, en un mot je lui ai dit « tout le paquet », et que Papa nous attendait à Vagney, ( Vagney que nous avions traversé pour nous rendre de Morbieux à Remiremont). Je lui ai précisé que si les camions repassent par là pour aller chercher d'autres évacués, ils pourraient nous déposer à Vagney.
« Les derniers convois sont déjà repartis. Ceux qui se préparent partent sur Rochesson » me répondit-il.
« Rochesson! Mais c'est justement Route de Rochesson que demeurent les cousins de papa » m'écriais-je.
« Voilà les camions, si deux chauffeurs veulent vous emmener à vos risques et périls, allez-y » me dit-il. Il m'a fallu moins de temps pour convaincre deux jeunes soldats, mais comme ils étaient prêts à partir, je devais aller chercher toute la famille en vitesse.
J'ai récupéré tout mon monde et ai lancé en passant devant le bureau : « Nous allons à Vagney ».
Nous y sommes arrivés vers dix huit heures, à l'heureuse surprise de papa et des cousins.
Papa était rentré depuis une demi-heure selon Barbe. Il était allé faire un tour au village et avait vu passer des camions pleins de gens du Thillot. Devant le nombre, il avait compris qu'il s'agissait d'une évacuation totale et se demandait où nous pouvions être.
Quelle joie de nous retrouver enfin réunis !
Les personnes âgées, invalides de l'hospice du Thillot ont été emmenées à Bussang par les Allemands.
Il était dix huit heures, la trêve était finie et les combats ont repris de plus belle.
De cette période de la guerre, il y a eu une quantité disparate d'anecdotes et de souvenirs. Chacun a raconté à sa façon ce qu'il a vécu. Ce n'était pas toujours conforme à la version de son voisin. Les mêmes événements ont été ressentis différemment par chacun, selon leur importance et par rapport à l'individu qui l'a subi. D'où cette disparité malgré l'authenticité de chaque événement.
Le lendemain de notre arrivée, nous avons appris, (par qui? Comment? Allez savoir!) que le convoi suivant le nôtre, au Ménil, était passé sur une mine. Un monsieur italien, que nous connaissions a été tué et une femme blessée.
Merci encore à Barbe et Jean Beretta qui nous ont accueillis, sans jamais nous laisser, même supposer que nous les embarrassions.
Nous étions plusieurs familles du Thillot chez des parents ou amis sur Vagney.
Papa et moi, sommes partis un matin, ce devait être le 28 ou 29 novembre. Le Thillot venait d'être libéré. Notre but était d'y aller en reconnaissance pour faire l'état des lieux avant d'y ramener la famille.
J'avais fais un rêve peu de temps avant. Je voyais des trous d'obus tout autour de la maison mais elle avait toujours le toit.
Nous nous sommes retrouvés à cinq, dont une femme du Thillot avec son petit garçon, sur la route de Dommartin Les Remiremont, en direction de Vecoux.
Au bout de quelques kilomètres, une Jeep nous a croisés et le chauffeur s'est arrêté. Il pouvait prendre deux passagers. D'un commun accord, nous avons désigné Mme Georges et son fils.
Il faisait beau et le chemin à parcourir ne nous faisait pas peur. Nous avions tout notre temps.
Nous arrivons à la maison vers midi. Ironie du sort, j'ouvre les volets et voilà que passe un convoi de militaires, c'était une partie de ceux qui logeaient dans la maison que nous venions de quitter à Vagney alors que nous venions de parcourir presque quarante kilomètres à pied.
Le toit de notre maison était presque intact, il ne manquait que quelques tuiles que nous avons vite remplacées. Il nous en restait dans un coin du grenier. L'intérieur des pièces n'avait pas souffert, mais il y avait des trous dans le mur intérieur de la cave, côté buanderie, et des débris tout autour. Était-ce un morceau de l'obus éclaté dans la cour? Ou un obus à bout de course? Nous n'avons pas cherché à comprendre. Il a fallu tout nettoyer et aussi sortir les cadavres des lapins de leurs clapiers.
Nous n'avions plus de vaisselle, nous avons retrouvé des couverts dans les pièces du dernier étage, près du grenier. (Ces pièces n'étaient pas à nous). Qui les avait déposés là ? Mystère ! (...)
Plus tard, du fait que René, l'ainé, était militaire, nous avions une pièce vide et mes parents ont logé, à plusieurs reprises, pour une nuit ou deux, des soldats de passage. Il y avait beaucoup de va et vient parmi eux. Des soldats cantonnaient dans une grange près de chez nous. Ceux qui dormaient une nuit dans la grange s'arrangeaient toujours pour dormir la nuit d'après dans un endroit plus chaud, chacun leur tour et personne ne leur refusait. (...)
La guerre continue, le froid, la neige aussi. Les usines reprennent le travail, cahincaha et nous voici à Noël. Un Noël joyeux et triste à la fois.
Ma tante tient un café, elle avait des pensionnaires avant la guerre, surtout des ouvriers italiens, et loge maintenant des soldats. Ils font leur popote dans la buanderie et aiment venir dans la salle de café pour discuter, lire, écrire et jouer aux cartes, ou tout simplement se reposer près du poêle chauffé à blanc. Les clients sont pour ainsi dire inexistants.
Pour le réveillon, les soldats ont invité ma tante et sa famille à partager le leur. Nous avons passé une bonne soirée sans oublier ceux qui se battaient et ceux qui se trouvaient derrière les barbelés.
Ma tante et moi sommes allés à la messe de minuit. Quelle ferveur cette nuit-là à l'église. Le premier Noël libre depuis quatre ans.
Le travail a repris normalement depuis janvier 1945. La municipalité a monté des baraquements en bois dans la cour de la mairie pour remplacer les écoles qui avaient souffert des bombardements. Les enfants sont donc retournés en classe.
Les premiers mois de l'année se sont déroulés comme les précédents, dans l'attente de la fin de la guerre. Les troupes avançaient en Allemagne, mais nous n'en savions pas plus.
Nous avons reçu des nouvelles de mon frère. Il était en Allemagne avec la 2ème DB du maréchal Leclerc.
L'hiver très rigoureux dure jusqu'en mars. Les restrictions continuent. Maman est de plus en plus malade. Nous ne le savions pas, mais elle attendait un bébé.
Elle essayait de faire ce qu'elle pouvait, mais avec une jambe toute enflée, elle ne pouvait guère tenir debout. Le docteur, de peur de suites fâcheuses, a immobilisé sa jambe dans une gouttière (armature de fer) pour une période de deux mois. Maman a dû rester couchée, elle avait une phlébite.
C'est pendant le temps de sa maladie que j'ai appris à faire mes premières tartes.
Voici le 8 mai qui nous annonce la victoire conjuguée des troupes et la fin de la guerre. L'Allemagne a capitulé.
C'est la liesse dans toute la France. Ce soir-là, Denise et moi avons eu la permission de sortir pour retrouver tous les jeunes. Nous avons pris en passant Simone qui venait aussi. Nous voilà sur la place du Ménil, il y a déjà là beaucoup de monde.
Jeunes, moins jeunes et même âgés, tous sont sortis, même quelques femmes de prisonniers.
« Enfin, nos maris vont rentrer et ce sera comme avant » disent-elles.
Ça grouille de monde, ça danse, chante et rit. Nous nous agrippons à une farandole et l'on crie comme les autres. Nous ne savons pas danser, mais quelle importance. On se dandine, saute à l'unisson. (...)
Je m'en étais donné à cœur joie, à tel point que le lendemain, en me levant, impossible d'émettre un son. Je me suis payée une extinction de voix pendant quatre jours ! (...)

yves philippe- MODERATEUR
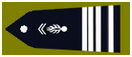
- Nombre de messages : 2134
Ville : le Ménil
Age : 60
Points : 2755
Date d'inscription : 28/12/2010
 Sujets similaires
Sujets similaires» LE THILLOT - SOUVENIRS DE LUCIEN PEDUZZI
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE JEAN CHEVRIER
» LE THILLOT - SOUVENIRS D’ANDRÉ PEDUZZI
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE RENÉ GROSJEAN
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL KURTZMANN
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE JEAN CHEVRIER
» LE THILLOT - SOUVENIRS D’ANDRÉ PEDUZZI
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE RENÉ GROSJEAN
» LE THILLOT - SOUVENIRS DE MARCEL KURTZMANN
FOREST :: VALLEE DE LA HAUTE MOSELLE, Rupt sur Moselle à Bussang :: "Recueil de témoignages sur le vécu sous la botte Allemande ( 39-45)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum