RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE GILBERT MANDLER
FOREST :: VALLEE DE LA HAUTE MOSELLE, Rupt sur Moselle à Bussang :: "Recueil de témoignages sur le vécu sous la botte Allemande ( 39-45)
Page 1 sur 1
 RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE GILBERT MANDLER
RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE GILBERT MANDLER
Prisonnier N° 72804
Je me nomme Gilbert Mandler, je suis né le 04 Février 1918. Je me suis marié le 26 Février 1938. J'ai été mobilisé le 09 Novembre 1939 à l'âge de 21 ans, soit deux mois après la déclaration de guerre.
Apres trois mois de classes accélérées, passées à Auxerre ( 89), je suis partis vers le Front de l'Est, sur la frontière Luxembourgeoise.
Affecté au 168eme Régiment d'Infanterie de Forteresse, 3eme Compagnie d'Intervalle de fusillés Voltigeurs, avec mes camarades, nous avons occupé les tranchées creusées devant les ouvrages de la ligne Maginot, pendant environ deux mois.
Le secteur était relativement calme, mis à part quelques escarmouches, à l'occasion de tentative Allemandes jusqu'au 10 Mai 1940 où les colossaux et soudains bombardements sifflent, déversés par les armées Allemandes et Italiennes, mitraillant les militaires mais aussi les interminables colonnes de réfugiés, provenant des tous les villages d'Ardennes , de Moselle et de Meurthe et Moselle, qui dans une débâcle monstre, pensaient protéger leur vie et sauver leur famille.
Dans une panique innommable, les chasseurs Messerschmitt ou les Italiens, survolent les routes, soumettent la population impuissante à leurs tirs en rafales, assassinant des milliers d'innocents avant de disparaître derrière une colline et revenir en rase motte poursuivre leur mise à mort, pendant que les gens encore valides tentaient tant bien que mal de s'occuper des blessés ou des morts.
Une nation entièrement dépassée.
Un agent de liaison nous communiquant un ordre de repli, nous informe que les gradés et les soldats qui occupaient les ouvrages de la ligne Maginot se sont repliés et que les ouvrages sont abandonnés. Notre ordre de mission nous désigne comme section sacrifiée et nous ordonne d'assurer la sécurité du repli de nos troupes et de retarder l'avancée Nazie qui se pressait à nos trousses compte tenu de notre vulnérabilité.
Notre direction de repli était Thionville, Metz, Nancy. Je saisi une opportunité qui avec l'accord de mon Chef, me permet de me rendre quelques heures chez des membres de ma famille demeurant à Tallange ( 57). Hélas à mon retour, ma section s'était volatilisée.
Beaucoup de soldats comme moi, rapidement séparés de leurs groupes respectifs, et pratiquement sans commandement, puisque certains hauts gradés se trouvaient déjà à Bordeaux, prirent l'initiative de se regrouper sans distinction de grade ou de régiment. Nous reformions des groupes hétérogènes et tentions de rester des soldats.
Fin Mai, début Juin 1940, je suppose que nos ennemis, comme nous dans le doute, nous ont cru plus nombreux. Dans un repli saccadé par des escarmouches et des coups de feu, parfois sanglants, et dans une pagaille monstre, à chaque croisement, nous apportions notre aide dérisoire aux pauvres familles fuyant, fuyant, vers je ne sais où, affamées, terrorisées, la peur de la mort aux entrailles.
Nous arrivons tant bien que mal sur Moulin Les Metz, où les Allemands, ayant contourné la France par le Nord-Est, s'infiltrant par la Belgique ( qui n'était pas jalonnée par la ligne Maginot, nous y avaient devancés, refermant sur nous sa tenaille implacable. Nous constatons aussi à notre grand écœurement, que la cinquième colonne a déjà pavoisé, sans perdre un instant, les bâtiments administratifs de la croix gammée.
Au soir du 16 Juin, épuisés, malades, pour beaucoup blessés, nous nous soutenions mutuellement, les godasses puantes et le corps aussi, ces godasses qui n'avaient pas quitté nos pieds sanglants depuis plus de quinze jours et que nous n'osions ôter de peur de ne plus pouvoir les enfiler à nouveau en raison du gonflement de nos pieds.
Nous étions plus de cinquante, couchés pêle-mêle dans un grand hangar sur de la paille destinée sûrement à des chevaux. Harassés de fatigue, nous nous sommes endormis, à bout de désespoir.
Avant que le jour ne se lève, tous les volets de cette baraque ont volé en éclats dans la même seconde et par toute les ouvertures, les fusils mitrailleurs et les grenades nous tenaient en respect que nous soyons morts ou vifs. L'écœurement de cette capture me fit vomir de honte impuissante.
Rassemblés, désarmés, à coups de crosses et de bottes, comptés et recomptés, étroitement surveillés, je vivais parmi eux le début d'un calvaire qui devait durer cinq ans.
Transportés à cinquante par camion non bâchés, de Metz à Ste Ménéhoulde, de nuit et sous une pluie diluvienne, nous sommes débarqués à coup de crosses comme du vulgaire bétail.
Cherchant vainement à tâtons un endroit pour dormir dans des baraquements déjà surchargés de prisonniers, je pris la parti de terminer ma nuit dans une simple caisse en bois qui au petit matin s'avère être un cercueil. Nous apprenons alors que nous sommes cantonnés dans un hôpital de campagne en cours de construction.
Attroupés le lendemain devant un orateur allemand qui parlait un Français parfait, nous reprenons espoir à entendre qu'après enregistrement de nos noms, prénoms et adresses, nous allons bénéficier d'une démobilisation rapide.
C'était sans compter sur la perfection de la propagande nazie qui nous apprend un jour plus tard que nos coordonnées seront utilisées au détriment de nos familles au cas où il nous prendrait des idées subversives.
Les douleurs n'arrivant jamais seules, j'ai appris longtemps après que ma section, que j'avais perdu de vue pour me rendre à Tallange, avait réussi à passer et que par le plus grand des hasards, s'était retrouvée en partie, après avoir subi une dramatique attaque sur Epinal, à Rupt Sur Moselle.
Cette nouvelle étant arrivée aux oreilles de ma femme, elle s'était précipitée à la gare où on lui a appris que si je n'étais pas duc convoi, c'est que j'avais été tué sur Epinal. Il lui faudra attendre Septembre pour comprendre à la réception d'une de mes lettres que je suis toujours en vie.
Mais revenons dans les Ardennes, où, embarqués à nouveau dans des trains inhumains , où nos gamelles servent autant à nos aliments qu'à nos urines, nous prenons, contraints, la route de l'Allemagne.
Arrivés à Mullberg Sur Elbe, nous sommes parqués au Stalag 4B, avant d'être répartis dans des baraques en bois. Dès lors, le Soldat Gilbert Mandler devient le prisonnier N° 72804. Dorénavant, instinctivement, s'incrustera en moi la rime suivante que je me fis fort de respecter le plus souvent possible : « Loin de la France, dans l'impuissance et la souffrance, silencieuse résistance ».
Nous sommes alors répartis en fonction de nos emploi respectifs dans des postes approchants. Pour ma part je m'étais arrangé pour être enregistré frauduleusement sous l'appellation « Ouvrier Agricole ». Je fus affecté à la ferme d'Otto Schonitz, à Moglens, Kreiss – Libernverda, en Saxe.
Nous partions les matins, à pieds, vers nos affectations, encadrés aux quatre coins par des soldats en armes. Plus tard, les contraintes liées à notre surveillance s'avérant trop importantes, des commandos ont été mis en place, c'est à dire des petits camps, dépendants des Stalags, mais situés à proximité des fermes ou usines qui nous employaient.
Très vite le système D est venu pallier les diverses carences en nourriture ou en matériels. Ainsi , avec mon copain Emile, nous « empruntions » aux cultivateurs chez qui nous travaillions des poulets que nous échangions contre du sucre auprès des camarades qui travaillent dans le sucrerie de Bretevitz. Un outil à ressouder nous servait généralement de motif pour nous rendre à la forge de cette affreuse raffinerie où se passaient les transactions.
La nature faisant quelques fois bien les choses dans cette ferme de Moglenz, les poules avaient remarqué que la fermière procédait au ramassage quotidien de leurs œufs, de ce fait elles cherchaient sans cesse de nouveaux nids que nous repérions discrètement. Un jour, je fais main basse sur une bonne douzaine d'œufs, que je dissimule comme à mon habitude dans mon blouson, disposé autour de ma taille, et supporté par mon ceinturon. Reprenant la route du camp, je me retrouve, au niveau de la porte de la cour, face au « Chef », le Schleu qui nous surveillait et que nous avions l'ordre d'appeler ainsi.
Il était en grande conversation avec un sous officier de la Wermacht. Ne pouvant faire demi-tour sans attirer l'attention, je passai à leur hauteur, les saluant de la main dans la plus pure tradition militaire. Ma démarche me permis de rejoindre ma baraque sans encombre, mais avec un teint aussi pâle que le plus blanc des blancs d'œuf. Mon teint laiteux n'avait pas manqué d'attirer l'attention de mes camarades de chambrée, toutefois la splendide omelette qui a suivi m'a remis de mes émotions. Je l'ai partagée dans la bonne humeur, avec Mimile Fleurot, de Rupt Sur Moselle, Georges Garnier de Dom Germain, et le grand Paul Etienne avec qui je garderai par la suite une amitié à vie.
Un autre jour, revenu trop t^t des champs, le « Chef » m'ordonne d'aller répandre deux sacs d'engrais sur les semis à l'autre bout du village. Malgré mes protestations, je fus contraint d'obéir et suis tout de même parti avec ma charrette et un cheval.
Il me fallut peu de temps pour vider mes deux sacs puisqu'une fois hors de vue, l'engrais se retrouva dans un petit ruisseau au cour rapide et profond. Apres m'être assuré de la totale dissolution de la poudre sur un laps de temps similaire à un épandage, je repris la direction du camp en faisant galoper ma jument sur la totalité du trajet, au grand dam du vieux paysan qui voulu que je bouchonne l'animal afin qu'il ne tombe pas malade.
Arguant l'heure tardive et mon obligation de revenir au commando pour 20h00, je laissai ainsi la bête fourbue de fatigue.
De même je mis un point d'honneur à ce que la convention de Genève soit respectée au mieux, ce qui créait de continuels conflits. Par exemple, je prenais comme prévu une heure de pause pour le repas de midi alors qu'à la ferme, le Schleu, sa femme et le gamin Polonais requis, mangeaient en moins d'une demie heure.
Inutile de vous décrire les regard hargneux dont je faisais l'objet lorsqu'à partir de plusieurs mégots, j'entreprenais alors le pénible travail de rouler une cigarette. Je considérais que je ne perdais pas de temps puisque le paysan le mettait à profit pour préparer ses chevaux et les atteler aux chariots.
Je pesais aussi que tous mon poids sur le respect des horaires de fin de travail. En effet, l'excès de certains qui se laissaient exploiter pesait sur l'action des autres qui revenaient au camp à l'heure. Les 30 malheureux Pfennigs journaliers, payés par un vulgaire papier sans valeur courante, utilisable dans les commerces locaux justifiant mon action.
Avec un copain Breton, nommé René Le Put, nous avons fait voter l'ensemble du commando pour instaurer un système d'amende à l'encontre de ceux qui ne respectaient pas la convention de Genève. Les sommes récoltées allant aux copains qui ne recevaient pas de colis et à ceux qui ne percevaient pas de salaire en raison d'une maladie.
Le barème était le suivant : 10 Pfg pour un quart d'heure de retard, 15 Pfg pour une demie heure et 20 Pfg pour une heure.
Comme cette pénalité réduisait rapidement le pécule journalier, la plupart sont rentrés dans les rangs, les retardataires s'arrangeant pour faire payer des dépassements d'horaires par leurs employeurs.
Certes, notre démarche limitait nos gains, mais aussi notre activité au profit de l'Allemagne, c'était bien là l'essentiel.
Quelques opposant avaient bien porté notre action à la connaissance de notre gardien mais comme il savait qu'il s'était livré sur notre dos à un détournement de savon à des fins personnels, lors de l'arrivé de colis de la Croix Rouge, il a eu la garantie de ne pas être récusé à ses supérieurs s'il n'intervenait pas dans notre règlement intérieur. Notre accord a tenu bon jusqu'à la libération.
Petit à petit, je me fis à la langue Allemande, ce qui me permit, au niveau de mon baraquement de faire profiter de mes connaissances à mes 21 camarades de chambrée, en leur servant d'interprète. Cela me permit d'intervenir entre autres, auprès du bureau de poste du village après que plusieurs d'entre nous constatèrent que leurs colis arrivaient délestés d'une partie de leur contenu.
Apres enquête des autorités Allemandes, un préposé aux postes a été interpellé suite à la découverte entre le bureau de poste et l''habitation voisine, un amas de déchets, dont des boites de sardines vides qui portaient encore l'inscription « Rose de France ». On ne pouvait pas trouver meilleur preuve.
Au printemps 1945, lorsque les Américains sont arrivés au bord de l'Elbe, quelques uns ont bien tenté de traverser le fleuve à la nage, mais les Américains les repoussaient en leur tirant dessus. En effet, ils ne pouvaient reconnaître telle ou telle nationalité à la façon de nager. Si bien que toute tentative se soldait par un retour rapide au camp.
Côté Est, les Russes sont également arrivés à notre hauteur mais la guerre froide a commencé à naître à notre détriment, entre les grandes puissances, les Russes n'acceptant pas de nous remettre aux Américains qu'à la condition que ceux ci leur remettent en échange des prisonniers de l'Est.
Nous avons vu des camions américains, initialement venus nous chercher, repartir à vide de l'autre côté de l'Elbe, parce qu'ils étaient venus également à vide.
Avec mes copains, René, François, deux Bretons, nous avons pris l'initiative de réquisitionner deux chevaux et une voiture et nous avons entrepris la tournée dans les fermes. De la même manière qu'en France, nous prélevions d'autorité, là un veau, là des œufs, là du lard, afin d'améliorer l'ordinaire du Stalag 4B.
Cette affaire a duré quelque temps jusqu'à ce matin du 28 Avril 1945 où à 05h00 du matin, nous sommes enfin libérés par l'armée régulière Russe et remis à 17H00 aux Américains.
Je suis arrivé à Rupt Sur Moselle le 31 Mai 1945. J'ai dû me réhabituer à cette vie civile et affronter le regard noir de certains ouvriers d'usine qui estimaient qu'on revenait pour leur prendre leur emploi.
S'il est certain que beaucoup de détails sur cette période m'échappent, ou s'estompent de ma mémoire, d'autres refont surface et viennent me réveiller en sursaut, comme pour dire : « N'oublie jamais », soixante dix ans après.
Pour nos enfants et nos arrières
Prions pour que ce soit la dernière.
Je me nomme Gilbert Mandler, je suis né le 04 Février 1918. Je me suis marié le 26 Février 1938. J'ai été mobilisé le 09 Novembre 1939 à l'âge de 21 ans, soit deux mois après la déclaration de guerre.
Apres trois mois de classes accélérées, passées à Auxerre ( 89), je suis partis vers le Front de l'Est, sur la frontière Luxembourgeoise.
Affecté au 168eme Régiment d'Infanterie de Forteresse, 3eme Compagnie d'Intervalle de fusillés Voltigeurs, avec mes camarades, nous avons occupé les tranchées creusées devant les ouvrages de la ligne Maginot, pendant environ deux mois.
Le secteur était relativement calme, mis à part quelques escarmouches, à l'occasion de tentative Allemandes jusqu'au 10 Mai 1940 où les colossaux et soudains bombardements sifflent, déversés par les armées Allemandes et Italiennes, mitraillant les militaires mais aussi les interminables colonnes de réfugiés, provenant des tous les villages d'Ardennes , de Moselle et de Meurthe et Moselle, qui dans une débâcle monstre, pensaient protéger leur vie et sauver leur famille.
Dans une panique innommable, les chasseurs Messerschmitt ou les Italiens, survolent les routes, soumettent la population impuissante à leurs tirs en rafales, assassinant des milliers d'innocents avant de disparaître derrière une colline et revenir en rase motte poursuivre leur mise à mort, pendant que les gens encore valides tentaient tant bien que mal de s'occuper des blessés ou des morts.
Une nation entièrement dépassée.
Un agent de liaison nous communiquant un ordre de repli, nous informe que les gradés et les soldats qui occupaient les ouvrages de la ligne Maginot se sont repliés et que les ouvrages sont abandonnés. Notre ordre de mission nous désigne comme section sacrifiée et nous ordonne d'assurer la sécurité du repli de nos troupes et de retarder l'avancée Nazie qui se pressait à nos trousses compte tenu de notre vulnérabilité.
Notre direction de repli était Thionville, Metz, Nancy. Je saisi une opportunité qui avec l'accord de mon Chef, me permet de me rendre quelques heures chez des membres de ma famille demeurant à Tallange ( 57). Hélas à mon retour, ma section s'était volatilisée.
Beaucoup de soldats comme moi, rapidement séparés de leurs groupes respectifs, et pratiquement sans commandement, puisque certains hauts gradés se trouvaient déjà à Bordeaux, prirent l'initiative de se regrouper sans distinction de grade ou de régiment. Nous reformions des groupes hétérogènes et tentions de rester des soldats.
Fin Mai, début Juin 1940, je suppose que nos ennemis, comme nous dans le doute, nous ont cru plus nombreux. Dans un repli saccadé par des escarmouches et des coups de feu, parfois sanglants, et dans une pagaille monstre, à chaque croisement, nous apportions notre aide dérisoire aux pauvres familles fuyant, fuyant, vers je ne sais où, affamées, terrorisées, la peur de la mort aux entrailles.
Nous arrivons tant bien que mal sur Moulin Les Metz, où les Allemands, ayant contourné la France par le Nord-Est, s'infiltrant par la Belgique ( qui n'était pas jalonnée par la ligne Maginot, nous y avaient devancés, refermant sur nous sa tenaille implacable. Nous constatons aussi à notre grand écœurement, que la cinquième colonne a déjà pavoisé, sans perdre un instant, les bâtiments administratifs de la croix gammée.
Au soir du 16 Juin, épuisés, malades, pour beaucoup blessés, nous nous soutenions mutuellement, les godasses puantes et le corps aussi, ces godasses qui n'avaient pas quitté nos pieds sanglants depuis plus de quinze jours et que nous n'osions ôter de peur de ne plus pouvoir les enfiler à nouveau en raison du gonflement de nos pieds.
Nous étions plus de cinquante, couchés pêle-mêle dans un grand hangar sur de la paille destinée sûrement à des chevaux. Harassés de fatigue, nous nous sommes endormis, à bout de désespoir.
Avant que le jour ne se lève, tous les volets de cette baraque ont volé en éclats dans la même seconde et par toute les ouvertures, les fusils mitrailleurs et les grenades nous tenaient en respect que nous soyons morts ou vifs. L'écœurement de cette capture me fit vomir de honte impuissante.
Rassemblés, désarmés, à coups de crosses et de bottes, comptés et recomptés, étroitement surveillés, je vivais parmi eux le début d'un calvaire qui devait durer cinq ans.
Transportés à cinquante par camion non bâchés, de Metz à Ste Ménéhoulde, de nuit et sous une pluie diluvienne, nous sommes débarqués à coup de crosses comme du vulgaire bétail.
Cherchant vainement à tâtons un endroit pour dormir dans des baraquements déjà surchargés de prisonniers, je pris la parti de terminer ma nuit dans une simple caisse en bois qui au petit matin s'avère être un cercueil. Nous apprenons alors que nous sommes cantonnés dans un hôpital de campagne en cours de construction.
Attroupés le lendemain devant un orateur allemand qui parlait un Français parfait, nous reprenons espoir à entendre qu'après enregistrement de nos noms, prénoms et adresses, nous allons bénéficier d'une démobilisation rapide.
C'était sans compter sur la perfection de la propagande nazie qui nous apprend un jour plus tard que nos coordonnées seront utilisées au détriment de nos familles au cas où il nous prendrait des idées subversives.
Les douleurs n'arrivant jamais seules, j'ai appris longtemps après que ma section, que j'avais perdu de vue pour me rendre à Tallange, avait réussi à passer et que par le plus grand des hasards, s'était retrouvée en partie, après avoir subi une dramatique attaque sur Epinal, à Rupt Sur Moselle.
Cette nouvelle étant arrivée aux oreilles de ma femme, elle s'était précipitée à la gare où on lui a appris que si je n'étais pas duc convoi, c'est que j'avais été tué sur Epinal. Il lui faudra attendre Septembre pour comprendre à la réception d'une de mes lettres que je suis toujours en vie.
Mais revenons dans les Ardennes, où, embarqués à nouveau dans des trains inhumains , où nos gamelles servent autant à nos aliments qu'à nos urines, nous prenons, contraints, la route de l'Allemagne.
Arrivés à Mullberg Sur Elbe, nous sommes parqués au Stalag 4B, avant d'être répartis dans des baraques en bois. Dès lors, le Soldat Gilbert Mandler devient le prisonnier N° 72804. Dorénavant, instinctivement, s'incrustera en moi la rime suivante que je me fis fort de respecter le plus souvent possible : « Loin de la France, dans l'impuissance et la souffrance, silencieuse résistance ».
Nous sommes alors répartis en fonction de nos emploi respectifs dans des postes approchants. Pour ma part je m'étais arrangé pour être enregistré frauduleusement sous l'appellation « Ouvrier Agricole ». Je fus affecté à la ferme d'Otto Schonitz, à Moglens, Kreiss – Libernverda, en Saxe.
Nous partions les matins, à pieds, vers nos affectations, encadrés aux quatre coins par des soldats en armes. Plus tard, les contraintes liées à notre surveillance s'avérant trop importantes, des commandos ont été mis en place, c'est à dire des petits camps, dépendants des Stalags, mais situés à proximité des fermes ou usines qui nous employaient.
Très vite le système D est venu pallier les diverses carences en nourriture ou en matériels. Ainsi , avec mon copain Emile, nous « empruntions » aux cultivateurs chez qui nous travaillions des poulets que nous échangions contre du sucre auprès des camarades qui travaillent dans le sucrerie de Bretevitz. Un outil à ressouder nous servait généralement de motif pour nous rendre à la forge de cette affreuse raffinerie où se passaient les transactions.
La nature faisant quelques fois bien les choses dans cette ferme de Moglenz, les poules avaient remarqué que la fermière procédait au ramassage quotidien de leurs œufs, de ce fait elles cherchaient sans cesse de nouveaux nids que nous repérions discrètement. Un jour, je fais main basse sur une bonne douzaine d'œufs, que je dissimule comme à mon habitude dans mon blouson, disposé autour de ma taille, et supporté par mon ceinturon. Reprenant la route du camp, je me retrouve, au niveau de la porte de la cour, face au « Chef », le Schleu qui nous surveillait et que nous avions l'ordre d'appeler ainsi.
Il était en grande conversation avec un sous officier de la Wermacht. Ne pouvant faire demi-tour sans attirer l'attention, je passai à leur hauteur, les saluant de la main dans la plus pure tradition militaire. Ma démarche me permis de rejoindre ma baraque sans encombre, mais avec un teint aussi pâle que le plus blanc des blancs d'œuf. Mon teint laiteux n'avait pas manqué d'attirer l'attention de mes camarades de chambrée, toutefois la splendide omelette qui a suivi m'a remis de mes émotions. Je l'ai partagée dans la bonne humeur, avec Mimile Fleurot, de Rupt Sur Moselle, Georges Garnier de Dom Germain, et le grand Paul Etienne avec qui je garderai par la suite une amitié à vie.
Un autre jour, revenu trop t^t des champs, le « Chef » m'ordonne d'aller répandre deux sacs d'engrais sur les semis à l'autre bout du village. Malgré mes protestations, je fus contraint d'obéir et suis tout de même parti avec ma charrette et un cheval.
Il me fallut peu de temps pour vider mes deux sacs puisqu'une fois hors de vue, l'engrais se retrouva dans un petit ruisseau au cour rapide et profond. Apres m'être assuré de la totale dissolution de la poudre sur un laps de temps similaire à un épandage, je repris la direction du camp en faisant galoper ma jument sur la totalité du trajet, au grand dam du vieux paysan qui voulu que je bouchonne l'animal afin qu'il ne tombe pas malade.
Arguant l'heure tardive et mon obligation de revenir au commando pour 20h00, je laissai ainsi la bête fourbue de fatigue.
De même je mis un point d'honneur à ce que la convention de Genève soit respectée au mieux, ce qui créait de continuels conflits. Par exemple, je prenais comme prévu une heure de pause pour le repas de midi alors qu'à la ferme, le Schleu, sa femme et le gamin Polonais requis, mangeaient en moins d'une demie heure.
Inutile de vous décrire les regard hargneux dont je faisais l'objet lorsqu'à partir de plusieurs mégots, j'entreprenais alors le pénible travail de rouler une cigarette. Je considérais que je ne perdais pas de temps puisque le paysan le mettait à profit pour préparer ses chevaux et les atteler aux chariots.
Je pesais aussi que tous mon poids sur le respect des horaires de fin de travail. En effet, l'excès de certains qui se laissaient exploiter pesait sur l'action des autres qui revenaient au camp à l'heure. Les 30 malheureux Pfennigs journaliers, payés par un vulgaire papier sans valeur courante, utilisable dans les commerces locaux justifiant mon action.
Avec un copain Breton, nommé René Le Put, nous avons fait voter l'ensemble du commando pour instaurer un système d'amende à l'encontre de ceux qui ne respectaient pas la convention de Genève. Les sommes récoltées allant aux copains qui ne recevaient pas de colis et à ceux qui ne percevaient pas de salaire en raison d'une maladie.
Le barème était le suivant : 10 Pfg pour un quart d'heure de retard, 15 Pfg pour une demie heure et 20 Pfg pour une heure.
Comme cette pénalité réduisait rapidement le pécule journalier, la plupart sont rentrés dans les rangs, les retardataires s'arrangeant pour faire payer des dépassements d'horaires par leurs employeurs.
Certes, notre démarche limitait nos gains, mais aussi notre activité au profit de l'Allemagne, c'était bien là l'essentiel.
Quelques opposant avaient bien porté notre action à la connaissance de notre gardien mais comme il savait qu'il s'était livré sur notre dos à un détournement de savon à des fins personnels, lors de l'arrivé de colis de la Croix Rouge, il a eu la garantie de ne pas être récusé à ses supérieurs s'il n'intervenait pas dans notre règlement intérieur. Notre accord a tenu bon jusqu'à la libération.
Petit à petit, je me fis à la langue Allemande, ce qui me permit, au niveau de mon baraquement de faire profiter de mes connaissances à mes 21 camarades de chambrée, en leur servant d'interprète. Cela me permit d'intervenir entre autres, auprès du bureau de poste du village après que plusieurs d'entre nous constatèrent que leurs colis arrivaient délestés d'une partie de leur contenu.
Apres enquête des autorités Allemandes, un préposé aux postes a été interpellé suite à la découverte entre le bureau de poste et l''habitation voisine, un amas de déchets, dont des boites de sardines vides qui portaient encore l'inscription « Rose de France ». On ne pouvait pas trouver meilleur preuve.
Au printemps 1945, lorsque les Américains sont arrivés au bord de l'Elbe, quelques uns ont bien tenté de traverser le fleuve à la nage, mais les Américains les repoussaient en leur tirant dessus. En effet, ils ne pouvaient reconnaître telle ou telle nationalité à la façon de nager. Si bien que toute tentative se soldait par un retour rapide au camp.
Côté Est, les Russes sont également arrivés à notre hauteur mais la guerre froide a commencé à naître à notre détriment, entre les grandes puissances, les Russes n'acceptant pas de nous remettre aux Américains qu'à la condition que ceux ci leur remettent en échange des prisonniers de l'Est.
Nous avons vu des camions américains, initialement venus nous chercher, repartir à vide de l'autre côté de l'Elbe, parce qu'ils étaient venus également à vide.
Avec mes copains, René, François, deux Bretons, nous avons pris l'initiative de réquisitionner deux chevaux et une voiture et nous avons entrepris la tournée dans les fermes. De la même manière qu'en France, nous prélevions d'autorité, là un veau, là des œufs, là du lard, afin d'améliorer l'ordinaire du Stalag 4B.
Cette affaire a duré quelque temps jusqu'à ce matin du 28 Avril 1945 où à 05h00 du matin, nous sommes enfin libérés par l'armée régulière Russe et remis à 17H00 aux Américains.
Je suis arrivé à Rupt Sur Moselle le 31 Mai 1945. J'ai dû me réhabituer à cette vie civile et affronter le regard noir de certains ouvriers d'usine qui estimaient qu'on revenait pour leur prendre leur emploi.
S'il est certain que beaucoup de détails sur cette période m'échappent, ou s'estompent de ma mémoire, d'autres refont surface et viennent me réveiller en sursaut, comme pour dire : « N'oublie jamais », soixante dix ans après.
Pour nos enfants et nos arrières
Prions pour que ce soit la dernière.

yves philippe- MODERATEUR
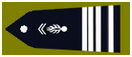
- Nombre de messages : 2134
Ville : le Ménil
Age : 60
Points : 2755
Date d'inscription : 28/12/2010

yves philippe- MODERATEUR
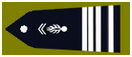
- Nombre de messages : 2134
Ville : le Ménil
Age : 60
Points : 2755
Date d'inscription : 28/12/2010
 Sujets similaires
Sujets similaires» FRESSE SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE GILBERT THOMAS
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS ANONYME
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE FERNAND MAUFFREY
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS D'YVAN CHONAVEL
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE GISÈLE CHIPOT
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS ANONYME
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE FERNAND MAUFFREY
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS D'YVAN CHONAVEL
» RUPT SUR MOSELLE - SOUVENIRS DE GISÈLE CHIPOT
FOREST :: VALLEE DE LA HAUTE MOSELLE, Rupt sur Moselle à Bussang :: "Recueil de témoignages sur le vécu sous la botte Allemande ( 39-45)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
